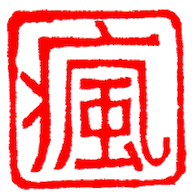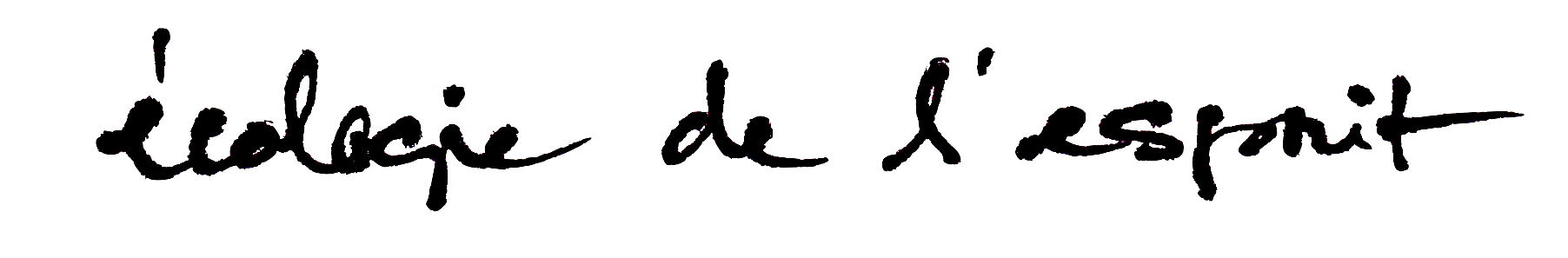Table des matières
Notre approche systémique et stratégique
Pour les visiteurs qui n’ont que des connaissances partielles sur les fondements de notre approche, nous proposons un résumé de l’histoire de l’Ecole de Palo Alto et de ses dernières évolutions.
Notre positionnement épistémologique :
Le paradigme systémique et constructiviste
Les idées présentées ici sont une émanation de ce que l’on a coutume d’appeler « le nouveau paradigme », issu des nouvelles disciplines scientifiques qui ont vu le jour vers le milieu du XXe siècle : la cybernétique, la théorie générale des systèmes et la théorie de l’information qui ont ouvert la voie à l’explosion de l’informatique et à la révolution culturelle d’internet.
Ces sciences sont différentes des sciences traditionnelles parce qu’elles ne s’intéressent pas directement aux « choses », aux objets, aux éléments, mais elles prennent en considération les relations entre les choses, ce qui les différencie et les relie, les organise, les structure… Elles s’intéressent aux interactions, aux processus dynamiques auxquels nous participons, nous les êtres humains. A la façon dont nous nous adaptons à notre milieu de vie, à la façon dont nous influençons et sommes influencés par nos semblables, et même à la façon dont nous essayons de contrôler notre propre organisme et notre propre pensée.

Elles éclairent donc tous les contextes dans lesquels nous vivons : nos relations familiales, professionnelles, sociales, nos rapports avec nos institutions, le passage du temps, les conditions de vie, et nos transformations inéluctables.
Gregory Bateson et l’école de Palo Alto
Ces nouvelles disciplines scientifiques ont permis à divers chercheurs, et notamment à Gregory Bateson (1904-80), un anthropologue d’origine anglaise, de revoir les fondements des sciences humaines à partir de ces nouvelles prémisses. Celles-ci permettent d’éclairer autrement nos expériences de vie ainsi que les difficultés qui peuvent survenir sur le parcours, par une approche à la fois globale et individualisée.
A partir de l’étude d’interactions paradoxales au sein de certaines familles, Bateson et son équipe ont proposé une théorie explicative relationnelle de la psychose, la « théorie de la double contrainte » (double-bind, 1956), ouvrant ainsi la voie au développement des thérapies familiales. Un des membres de l’équipe, Don Jackson, va fonder le premier institut de thérapie familiale, le Mental Research Institute (MRI, 1959) de Palo Alto (CA) afin d’élaborer des outils de traitement des troubles mentaux adaptés à cette nouvelle façon de concevoir le comportement humain. Fortement influencé par les travaux de Milton Erickson et son utilisation de l’hypnose, le modèle de résolution de problèmes de Palo Alto, la « thérapie brève », va très vite accorder une place importante à l’individu en tant que sous-système.
Elle propose aussi une méthode active de diagnostic et d’intervention permettant de soulager la souffrance psychologique générée par les interactions dysfonctionnelles.
La « construction de la réalité »
L’individu fait partie de nombreux systèmes qui contrôlent son comportement, qui le façonnent en quelque sorte (nous sommes transformés par nos relations familiales et par notre culture…) Comment, au centre de toutes ces contraintes systémiques (redondances), l’individu arrive-t-il à se construire une identité, à donner un sens à sa relation au monde ?
En plus des apprentissages adaptatifs que l’homme fait au cours de ses interactions avec son milieu, « l’homme sait qu’il sait », comme disait Bateson. L’individu est couplé à son environnement par une conscience réflexive articulée autour du langage (où les mots sont mis pour les choses). Pour faire simple, disons que si l’homme vit sa vie, fait des apprentissages processifs dont il n’a qu’une conscience très limitée, il s’en fait aussi une représentation mentale. Cette représentation mentale ne peut prétendre à l’objectivité et, loin de percevoir la « réalité » telle qu’elle est en elle-même, l’homme ne fait que construire, inventer même, sa propre réalité.
La réalité que l’individu peut ainsi connaître réflexivement n’est donc qu’une construction personnelle qui n’a valeur de réalité absolue que pour lui-même. Les leçons — largement influencées par la culture et les diverses pressions sociales — qu’il tire de son histoire, de ses expériences, reflètent ces différents biais perceptifs mais constituent en même temps les repères conscients qu’il utilise pour « réfléchir » sa vie.
Traversé par les influences des systèmes auxquels il appartient, l’homme dispose donc néanmoins d’une autonomie relative qui en fait également un constructeur de sens, un constructeur de réalité. Mais nous n’avons pas une connaissance directe de ce processus de construction de réalité, nous avons souvent la conviction que ce que nous percevons est la réalité. C’est ce qui conduit von Fœrster à dire : « Selon moi, ce que recouvre le constructivisme devrait rester une attitude pure et simple de mise en doute de l’auto-évidence du réalisme. (1) »
Communication, santé mentale et troubles psychiques
Ces deux aspects de l’être humain, systémique et constructiviste, indissociablement liés, permettent à la fois de rendre compte de la complexité de l’homme et des nombreuses difficultés « psychologiques » qu’il peut rencontrer. Cette double épistémologie permet en effet de mieux comprendre comment « nous » - l’image que nous construisons de nous-mêmes en tant que « sujets » de nos expériences – pouvons imaginer exercer un contrôle sur les déterminants systémiques (redondances entre l’environnement et nous-mêmes) qui nous constituent. Le couplage de ces deux systèmes peut, en effet, faire apparaître des décalages plus ou moins importants (par exemple l’idée que par la volonté - concept abstrait inventé par l’homme - un individu peut contrôler ses émotions) comme nous le verrons régulièrement sur ce site. Nous donnerons de multiples exemples qui illustreront la façon dont notre construction du monde peut devenir notre prison et nos interactions générer de la souffrance psychique. Une relation difficile avec notre entourage ou avec nous-mêmes peut nous compliquer la vie, nous perturber l’esprit, modifier notre perception de l’environnement, l’image que nous avons du monde et de nous-mêmes, et même nous faire douter, au plus profond de nous, de notre identité. Nous montrerons aussi comment un thérapeute peut interagir à son tour avec un patient, utiliser des stratégies interactionnelles, des techniques verbales et non verbales (donc des formes de communication) pour faire en sorte que le patient trouve des formes plus satisfaisantes d’interaction avec lui-même, les autres et le monde. Bref, pour nous comme pour Gregory Bateson, la communication est la matrice de la santé mentale.
Notre méthode thérapeutique…
Le modèle d’intervention systémique et stratégique
Appliquant les découvertes de la cybernétique, les psychothérapeutes stratégiques ne vont pas focaliser leur travail sur la recherche des « causes » des problèmes dans le passé. Selon le principe systémique d’équifinalité (2), en effet, les causes d’un comportement sont multiples et, de plus, une même cause ne provoque pas forcément les mêmes effets : un traumatisme dans l’enfance peut conduire à une vie cauchemardesque à l’âge adulte, ou, au contraire, procurer une force hors du commun, ceci en fonction des expériences ou des rencontres post-traumatiques (3).
Plutôt que de partir à la recherche de « causes » hypothétiques à une conduite donnée, l’approche systémique invite donc le thérapeute à se focaliser sur la façon dont le système fonctionne « ici et maintenant ». Ce n'est pas en en amenant les patients à prendre conscience de l'impact de l'expérience passée qu’on les guérit, mais en les aidant à trouver des solutions aux difficultés engendrées par le passé dans leur vie actuelle.
Le phénomène d’adaptation
Comment des difficultés peuvent-elles apparaître dans la vie d’une personne ? L’individu fait partie de nombreux systèmes, comme nous l’avons vu (famille, groupes socioculturels divers, etc.), mais il peut lui-même être considéré comme un système ouvert sur son environnement, et, comme tel, il doit s’adapter aux changements, tant internes qu’externes, c’est-à-dire veiller à maintenir ses « variables essentielles » à l’intérieur de limites qui lui permettent d’assurer sa survie physique et psychologique. Face à une difficulté ou à un inconfort durable, chacun met en œuvre une série de conduites visant à lui procurer le soulagement. La plupart du temps, nous trouvons la façon de réagir qui met un terme à la difficulté : lorsque nous avons soif, nous allons boire ; lorsque nous avons peur, nous nous mettons à l’abri ; lorsque nous sommes agressés, nous réagissons de façon à nous protéger efficacement, etc. Cependant il arrive que ces conduites de régulation ne nous permettent pas de retrouver un équilibre satisfaisant, et la difficulté perdure voire s’amplifie : notre peur grandit et devient envahissante malgré nos efforts pour l’apaiser, notre relation conjugale se dégrade en dépit de nos tentatives de réconciliation, ou encore nous perdons de plus en plus le contact avec nos enfants alors que nous déployons les moyens les plus créatifs pour nous en rapprocher, etc. Le processus interactionnel s’emballe alors que nous cherchons au contraire à en réduire les effets indésirables.
Régulation et « tentatives de solution »
Selon l’école de Palo Alto, si nous ne pouvons pas empêcher les changements continuels internes ou externes, tout ce que nous pouvons faire c’est y trouver la parade adéquate pour maintenir un équilibre satisfaisant. C’est donc à ce niveau que l’on peut agir : si une personne n’arrive pas à mettre un terme à l’inconfort ou à la souffrance, c’est que les moyens qu’il déploie pour ce faire ne sont pas adéquats. Ce sont ces efforts infructueux pour trouver le soulagement que l’école de Palo Alto appelle les « tentatives de solution » : elle considère que le premier travail du thérapeute consiste à mettre un terme à ce processus dysfonctionnel.
La cible du traitement devient donc l’arrêt des tentatives de solution qui, au lieu de permettre une disparition du problème, enveniment la situation par un processus d’amplification de la difficulté.
Un mode d’intervention non normatif
Nous verrons plus loin que toutes les difficultés personnelles, relationnelles, familiales, peuvent s’analyser de cette manière. Il n’est dès lors plus nécessaire de recourir à une vision normative des difficultés psychologiques mais de suivre le patient dans son désir d’évolution. De plus, et c’est sans doute là l’aspect le plus révolutionnaire de l’approche, le thérapeute ne doit pas savoir ce qui est bon ou non pour son patient dans l’absolu : ce sont les efforts inefficaces du patient lui-même qui indiquent, par un virage à 180 degrés, la voie de la solution. Le thérapeute n’est plus le gardien de l’ordre moral ou de la normalité, il devient agent de changement au service de son patient.
C’est ainsi que le clinicien devra apprendre à créer un contexte relationnel sécurisant, à manier les techniques de changement (notamment le questionnement stratégique et l’art du recadrage) et se montrer suffisamment créatif pour imaginer des prescriptions, c’est-à-dire des « tâches », des expériences concrètes qui, lorsque le patient les mettra en œuvre, le conduiront inévitablement à renoncer à ses tentatives de solution habituelles. Elles sont soigneusement construites en vue d’amener le patient à vivre une « expérience émotionnelle correctrice » (Alexander) nécessaire pour provoquer un changement durable dans la situation du patient.
Le système de perception/réaction
Nous savons que les réactions d’un individu face à un problème, donc ses tentatives de solution, dépendent de la manière dont il perçoit la situation, il est donc important de bien comprendre les différents éléments qui influencent, qui construisent la perception. La perception est un phénomène complexe qui constitue le résultat global et immédiat de nombreuses composantes : l’histoire et les apprentissages de la personne, ses sensations, ses attentes, les pensées qui sont associées… Les recadrages, les prescriptions et les tactiques thérapeutiques diverses sont surtout conçues pour changer les interactions directement ou l’un ou plusieurs aspects de l’expérience de perception/réaction, et ce en fonction du type de problème.
Les évolutions de notre travail ont permis de montrer l’intérêt et l’efficacité de la méthode interactionnelle et stratégique pour le traitement de nombreux troubles mentaux décrits dans le DSM, tels que les phobies, les tocs, les troubles alimentaires, la dépression, et même les troubles dits « psychotiques »… , même si la façon de les traiter remet parfois en question les catégories définies.
Les trois grandes catégories de tentatives de solution
C’est face à une sensation désagréable ou effrayante, pénible ou douloureuse, que l’on peut voir quel type de tentative de solution un individu met en œuvre. Il nous est apparu qu’il peut chercher le soulagement de trois façons : il peut la fuir, chercher à la contrôler, ou vouloir confirmer sa « croyance » quant à la nature du problème.
1. La première catégorie de tentatives de solutions repose sur la fuite, l’évitement, le retrait. Il cherche à échapper à des sensations désagréables et, dans un premier temps cette réaction met un terme au problème ; mais il s’avère que ce type de régulation, lorsqu’il est dysfonctionnel, entraine une dégradation bien plus importante de la situation dans un deuxième temps. C’est ce que nous appelons les tentatives de solution fondées sur la logique de l’évitement.
2. La deuxième consiste en une réaction visant à exercer une action, à contrôler la situation désagréable ou menaçante ou à l’anticiper alors qu’elle n’est pas contrôlable. C’est ainsi que se construit le piège du paradoxe. Dans ce cas, nous parlerons de logique du contrôle ou logique paradoxale. Il s’agit du type de difficultés le plus étudié par l’école de Palo Alto.
3. La troisième catégorie de tentatives de solution repose sur une identification erronée du problème, une attribution causale (« c’est la faute à qui ou à quoi ? »), une explication qui définit la cause du problème et qui donc est censée donner les moyens de s’en protéger. Certains patients « savent » ce qui cause leur réaction émotionnelle et se comportent de façon à confirmer leur « croyance (4) » ; ils sont aveugles à toute information qui pourrait l’infirmer. Identifier un ennemi par exemple, permet de focaliser toute notre action sur lui pour nous en protéger. Cela paraît donc fonctionnel… sauf si l’ennemi est imaginaire ! Nous appellerons ce processus la logique de validation d’une « croyance ».
La « logique » du problème
Nous pensons que des mécanismes adaptatifs communs à tous les individus peuvent, dans certaines circonstances, s’emballer à partir d’un mouvement qui paraît « logique » au patient mais qui s’avère inapproprié au vu de ses conséquences. Ces processus peuvent former des équilibres stables mais dysfonctionnels (générant de la souffrance psychique) qui présentent une cohérence interne que l’on peut faire émerger par le questionnement stratégique. Si nous ne basons pas nos explications des troubles sur les causes passées, nous proposons néanmoins une explication cybernétique de leur formation et de leur fonctionnement. Nous avons aussi mis au point un dispositif systémique et stratégique pour leur traitement : le « diagnostic opératoire systémique et stratégique » (DOSS).
Nous pensons que les différences entre chacun d’entre nous reflètent la diversité de notre condition humaine et la santé mentale de notre planète. Pour nous, un « trouble psychologique » est un mode de régulation dysfonctionnel récurrent des interactions entre la personne et son environnement et/ou elle-même. Il est dysfonctionnel parce qu’il génère de la souffrance psychologique. Ces régulations n’impliquent pas la présence de lacunes ou de déficits particuliers chez les individus concernés car, comme le dit Canguilhem « Il ne peut rien manquer à un vivant, si l’on veut bien admettre qu’il y a mille et une façons de vivre. »
Qu’on appelle cet équilibre dysfonctionnel « maladie », « pathologie », « trouble » ou « dysfonctionnement » importe finalement assez peu si l’on entend le terme maladie au sens où Georges Canguilhem le définit et qui nous semble transposable à la vie psychologique : « le propre de la maladie, c’est d’être une réduction de la marge de tolérance des infidélités du milieu ». Et si, bien sûr, l’on n’en déduit pas ipso facto qu’il faut chercher les agents responsables dans le cerveau du patient et que l’on ne considère pas que le traitement d’une maladie passe obligatoirement par l’ingestion de médicaments. Les prescriptions, ici les tâches proposées, sont de la même nature que les troubles - virtuelles donc - même si elles ont des effets bien concrets.
Intéressé ? Envie d’en savoir plus ? Ceci est pour vous :
La force principale du modèle de Palo Alto, c’est qu’il propose une méthode, une méthode de résolution de problèmes personnels et relationnels, une méthode identique quel que soit le contexte dans lequel ce problème se manifeste. Cette méthode permet de comprendre la façon dont les problèmes « fonctionnent », d’en saisir la « logique », et, du coup, de pouvoir élaborer une stratégie de changement efficace et réaliste et de créer un contexte relationnel de confiance qui incite le patient (ou le client) à suivre les prescriptions suggérées par l’intervenant.
C’est cela qui attire tous les participants qui ont déjà suivi des formations telles que PNL, hypnose éricksonienne, pleine conscience, thérapies orientées solutions, sophrologie, etc. Ils ont le sentiment de pouvoir situer leurs acquis dans un cadre global cohérent.
Alors, si vous souhaitez être initié de façon rigoureuse et étayée à l’approche systémique et stratégique par un praticien confirmé, et selon le domaine qui est le vôtre, nous vous proposons :
Initiation à la thérapie systémique et stratégique (2 ou 3 journées animées par J.-J. Wittezaele)
[ Menu ]
Communication et relations humaines
Dans cette rubrique, vous trouverez des informations concernant les derniers développements de la « pragmatique de la communication », qu’ils concernent de nouvelles distinctions théoriques ou des pratiques nouvelles.
Pour commencer, voici la retranscription d’une interview de votre serviteur menée par Grégory Lambrette. Elle vise à faire le point sur les spécificités de l’entretien ou du dialogue stratégique. Je suis en effet de plus en plus frappé par les potentialités de l’entretien systémique et stratégique tel que nous l’utilisons. Qu’il s’agisse du travail de psychothérapie ou de coaching, bien sûr, mais aussi du travail de négociation, d’ouverture respectueuse à l’autre et même comme outil d’intégration sociale et culturelle dans l’enseignement. En attendant un texte sur ce sujet (en préparation), vous pourrez aussi trouver sur ce site une application de ses avantages en psychiatrie
Savoir écouter, oser intervenir : réflexions sur le dialogue stratégique
Entretien de Jean-Jacques Wittezaele et de Grégory Lambrette
GL : Qui s’intéresse à la place du dialogue stratégique dans le modèle systémique et stratégique de Palo Alto s’aperçoit assez rapidement que cette notion est relativement récente. Elle n’apparaît en effet pour ainsi dire pas dans les premiers écrits des pères fondateurs que sont Jackson, Weakland ou même Haley. Je n’irais pas jusqu’à dire que ces pionniers du modèle stratégique ne sont pas intéressés à la dimension conversationnelle de la psychothérapie, mais l’idée même d’un dialogue s’appuyant sur une modélisation cybernétique des problèmes humains n’apparaît guère avant les travaux de Giorgio Nardone.
J-J W : C’est vrai. Lorsque Teresa (Garcia) et moi avons écrit « A la recherche » alors que nous étions à Palo Alto, j’ai été frappé par le parallèle entre le principe des « tentatives de solution » et le processus de régulation par feed-back de la cybernétique. Je ne pense pas que les membres de l’équipe du MRI y avaient pensé eux-mêmes, Watzlawick parlait plutôt de « réducteur de complexité » et Dick Fisch n’aimait pas trop les liens théoriques avec la systémique. Moi j’aime bien ça, et j’ai toujours trouvé que la cybernétique donnait sa cohérence à toute l’approche interactionnelle de Palo Alto. Donc il est logique qu’on ne trouve pas de trace d’une modélisation cybernétique dans les écrits de l’équipe du MRI.
De plus, on ne parlait pas non plus du processus de l’entretien thérapeutique comme d’une conversation, d’un échange autorégulé, on insistait plus sur certains de ses aspects : parler le langage du client, définir le problème, déterminer un objectif réaliste…
Et puis, il fallait surtout questionner pour savoir quel était le problème. Mais, quelque part, questionner pour savoir quel est le problème, cela implique qu’un « problème » existe indépendamment des tentatives de solution. Et c’est là peut-être que les pères fondateurs étaient peu congruents. Dick Fisch disait lui-même que le thérapeute disposait de neuf séances et demie pour connaître le problème. Le questionnement, du coup, pouvait devenir très harcelant pour les personnes peinant à préciser ou à identifier ce qui les faisait souffrir. En même temps, Watzlawick affirmait : « Le problème, c’est la solution ! » Un paradoxe de plus pour Palo Alto.
GL : Sais-tu au fond ce qui a amené Nardone précisément à développer cette notion de « dialogue stratégique » ?
J-J W : Giorgio a assez vite distingué trois aspects dans le travail thérapeutique : la stratégie, la relation et la communication. La stratégie, c’est déterminer le mouvement général nécessaire pour arrêter les tentatives de solution, la relation c’est arriver à établir un climat de confiance, à se syntoniser avec le patient, et enfin, la communication, c’est trouver la façon de modifier le système de perception/réaction du patient pour qu’il puisse renoncer à ses tentatives de solution et/ou mettre en pratique les suggestions du thérapeute. Ces différents aspects s’entremêlent dans le dialogue stratégique.
Cela a conduit Nardone à formaliser un peu plus le « langage du changement », l’utilisation d’un langage du cœur plutôt que de l’esprit, etc. Ensuite, avec l’expérience de plus en plus grande qu’il acquérait, il a vu des possibilités de faire des raccourcis. Par exemple, il a d’abord constaté que, pour les troubles anxieux, les gens qui avaient peur, soit avaient peur de mourir, soit de devenir fou. Dès qu’un patient évoquait ce type de problème, il posait la question fermée : « Vous avez peur de mourir ou de perdre le contrôle ? » Ainsi, en une seule question, il éliminait pas mal d’incertitude et le travail avançait d’autant plus vite. Et moi, je me disais : « comment sait-il qu’il n’y a pas d’autres possibilités ? », j’étais incrédule.
C’est lorsque j’ai perçu les grands types de thèmes de tentatives de solution, comme on disait à l’époque de Dick Fisch, les grandes « logiques » comme je les appelle, que j’ai compris pourquoi Giorgio posait ces questions discriminantes. La nature des processus de régulation revient toujours à une question de choix binaire : on fait ou on ne fait pas ! Il s’agit d’un feed-back positif ou négatif ? L’interaction s’apaise-t-elle ou pas après ? La vie psychologique est faite d’une suite de décisions.
GL : Si je ne m’abuse, et pour t’avoir déjà entendu évoquer la chose, tu préfères la notion de « questionnement stratégique » à celui de « dialogue stratégique ».
J-J W : J’ai revu ma position à ce sujet-là. Giorgio a commencé à parler de dialogue stratégique à l’époque de ces questions fermées que je viens d’évoquer. Comme j’étais sceptique et peu désireux de cautionner une analogie que je trouvais inappropriée, je voulais marquer ma différence en parlant d’entretien ou de questionnement stratégique plutôt que de dialogue.
GL : Car cela te semblait trop réducteur au départ pour ce qui touchait aux problèmes relationnels et donc, cela fermait un peu trop vite les possibilités de réactions potentielles face à un ou des problèmes.
J-J W : Oui, je trouvais cela trop caricatural. N’oublions pas l’idée principale du dialogue stratégique, c’est quand même de bien traiter les gens. Déjà ne pas rajouter à leurs difficultés, par exemple en les étiquetant ou en les traitant comme des personnes « bizarres » ou même différentes. On sait les ravages que peuvent faire les étiquettes, non seulement pour la perception que la personne a d’elle-même et de ses capacités à affronter le monde, mais aussi socialement, relationnellement.
Donc, on ne va pas les observer comme des bêtes curieuses et essayer de déterminer ce qu’ils ont de différent. Notre façon de procéder n’a rien à voir avec les entretiens psychiatriques traditionnels dans lesquels les psychiatres essaient de déterminer à quelle catégorie psychopathologique appartient leur patient, pour ensuite déterminer le traitement qu’il leur faut. La tendance à réduire la patient à ses symptômes, à imposer sa vision « scientifique » des choses ainsi que le traitement, sans trop se préoccuper de la façon dont le patient le vit ni des conséquences que le traitement peut avoir sur la qualité de sa vie…
G L : Peux-tu expliquer comment se déploie ou se déroule un dialogue stratégique ?
J-J W : Le dialogue stratégique est un processus autocorrecteur, c’est-à-dire qu’il demande que le thérapeute vérifie régulièrement qu’il a bien saisi la façon dont l’autre vit les choses, et qu’il rectifie le cas échéant. Tu sais, le fameux « corrige-moi si je me trompe » de Giorgio. La reformulation est essentielle pour construire ce dialogue et le faire évoluer.
Alors, il s’agit de le faire évoluer comment ? Eh bien, disons que le patient perçoit sa situation à partir de ses propres coordonnées en quelque sorte. En fonction de son histoire personnelle et des apprentissages secondaires qui l’ont transformé, mais aussi en fonction de l’intensité émotionnelle qui l’accompagne, qui la colore. En fonction de ses attentes, des redondances relationnelles qui limitent sa perception, de ses sensations physiques, physiologiques, etc., etc., bref en fonction de toutes une série de paramètres que l’on pourrait représenter comme une sorte d’espace dont les dimensions sont représentées par les composantes du système de perception/réaction.
Le thérapeute va partir de là, mais, par ses questions et ses commentaires, il va transposer les coordonnées de son patient sur les siennes.
Toute la démarche du dialogue stratégique, consiste à transformer les plaintes (qui peuvent être de nature diverse) du patient en un modèle dynamique, un enchaînement de processus interactionnels qui forment le « trouble » spécifique présenté par le patient. Cet enchaînement de cause et d’effets est circulaire, c’est-à-dire qu’il comporte un mode de régulation inadéquat (tentative de solution) qui ne permet pas la résolution du problème et fait en sorte que ce pattern devienne permanent ou chronique.
Le dispositif comporte différentes étapes. D’abord, comme d’habitude, on demande au patient de nous dire, à sa façon, ce qui ne va pas. Pas d’explications, pas d’analyses, pas d’interprétations, des faits : qu’est-ce qu’on a dit, qu’est-ce qu’on a fait ? Cette opération est destinée surtout à mobiliser le patient, à le remettre au cœur de l’action et à abandonner sa position de spectateur commentateur de « ce qui lui arrive ». Les abstractions doivent être traduites en actions pour donner prise aux interventions ; la réalité de 2ième ordre doit être exprimée en réalité de 1er ordre (comme aurait pu dire Watzlawick). Le thérapeute veut comprendre l’enchainement des événements plutôt que l’analyse qui en a été faite.
Cette étape déconcerte surtout les psychiatres traditionnels et les personnes qui évoluent en entreprise, les managers, les RH… Ils ont passé beaucoup de temps à analyser les difficultés qu’ils rencontrent, ou alors ils ont déjà demandé un audit qui leur a procuré une analyse et des mesures correctrices, et ils s’attendent donc à ce que la stratégie consiste à savoir comment faire passer les mesures auprès du personnel concerné. Alors quand l’intervenant se met à vouloir tout recommencer, ça surprend. Mais quand le dialogue commence, les personnes sentent que les choses ne se déroulent pas comme d’habitude, qu’on s’intéresse à ce qu’ils ont vraiment vécu, ressenti, pensé, qu’on cherche non pas à connaître la « vérité » au-delà d’eux-mêmes, mais leur vérité. Il n’y a pas « un problème » qui serait le même pour tous, il y a une situation qui est perçue comme telle par certains et c’est cela que le thérapeute ou le coach ou le consultant doit saisir.
GL : On peut donc transformer la réalité ?
J-J W : Pour nous, la réalité avec laquelle nous travaillons est malléable, on peut la transformer en organisant autrement les éléments de connaissance. On met les pièces dans un ordre différent, on les configure autrement, de manière à qu’une solution différente se profile.
C’est en cela que nous nous démarquons de l’approche expérimentale cartésienne traditionnelle, nous ne cherchons pas à imposer notre forme à la situation, donc à imposer nos prémisses, à les considérer comme plus pertinentes que les leurs. C’est en cela que notre approche est respectueuse de l’autre, qu’elle est vraiment égalitaire : chacun a le droit de voir le monde à sa manière ! Et les patients ressentent cela aussi. Quelque chose comme : « Tiens, il parle comme tout le monde, tiens, il tient compte de mon point de vue, tiens, il ne me juge pas, tiens il me répond quand je pose une question, il ne laisse pas supposer que je ne comprends pas et que lui comprend bien mieux que moi. Il me parle vraiment comme à un être humain digne d’être son interlocuteur. Mais il ne fait pas que m’écouter sans réagir, il fait des commentaires, il pose des questions de détails, demande des précisions, s’étonne… non seulement je me sens écouté mais je me sens en sécurité parce qu’il peut entendre toute ma misère sans paraître dépassé, accablé… il poursuit l’entretien « comme si il entrevoyait une solution »…
Les mesures que nous proposons apparaissent comme « logiques » à la fin du dialogue, parce qu’elles auront été proposées suite à tout un processus qui conduit naturellement à cette conclusion et qu’elles laissent augurer d’un résultat concret.
GL : Le résultat concret, c’est là une notion à laquelle s’en est adjoint une autre qui est celle de la stratégie. Pour faire émerger de l’information et rendre aversives les tentatives de solution. Même s’il ne s’agit pas que de rendre les tentatives de solution aversives.
J-J W : Je dirais plutôt faire en sorte que le patient perçoive que ses tentatives de solution sont nocives pour lui. On ne les rend pas aversives, leur caractère « aversif » devient perceptible pour le patient. Le questionnement vise à permettre à la personne de sentir, en fonction de ce qu’elle poursuit, que ce qu’elle met en œuvre n’est pas adéquat. Et ça, c’est tout l’art du questionnement et de que l’on met dedans, comme commenter, ponctuer par un regard, un froncement de sourcil, par une histoire, etc.
GL : Ces commentaires sont au service du thérapeute qui s’essaie à capter donc la façon dont le patient agit et réagit ; la manière dont il vit, sent, pense.
J-J W : On cherche à comprendre l’histoire que le patient a élaborée autour de ses difficultés, et à en suivre le déroulement. On pose des questions d’éclaircissement quand on ne comprend pas. On peut s’étonner, rire à certains moments. Mais même ce rire contribue à la stratégie, ou plutôt il montre que nous avons saisi le mouvement qui conduit à l’impasse, que nous anticipons déjà une chute « annoncée »… Nous partageons le récit et les émotions qui l’accompagnent. Nous marquons notre compréhension lorsque la personne nous fait part de ses explications, des liens de causalité qu’il fait entre les événements. Sauf lorsque nous percevons que le récit s’engage dans des actions qui font partie des tentatives de solution. Nous arrêtons alors le récit en demandant des éclaircissements sur la séquence décrite, nous en interrogeons les conséquences (et quand vous faites cela, vous vous sentez mieux après ? Ou plus mal ?) Nous interrogeons la nécessité de ce comportement (Vous faites cela pour telle raison, OK, mais en fin de compte cela vous est-il bénéfique ?)
Nous agissons comme cela pour tous les éléments perceptifs qui contribuent à la réaction inadéquate. Par exemple :
- Les attentes : ah oui, vous faites cela pour que tel résultat se produise, mais est-ce le cas ?
- L’histoire : comme vos parents vous ont mis en garde contre les dangers de ce monde, vous avez tendance à anticiper tous les risques…
- Les émotions : vous êtes tellement fâché que vous en oubliez vos bonnes résolutions et vous perdez le contrôle pour le regretter tout se suite, vous excuser platement et essayer de mieux contrôler la prochaine fois… C’est bien ça ? Et vous faites des progrès ? (Rires)
- Les rigidités cognitives : vous vous dites que vous ne pouvez pas faire marche arrière et que vous devez mettre votre menace à exécution, même si vous trouvez alors qu’elle est exagérée, n’est-ce pas ? Du coup, j’imagine que vous devez le faire avec conviction ! (Rires)
Au cours de l’entretien, des éclaircissements sont apportés, des nouveaux liens tissés, des portes sont fermées, des objectifs précisés, des hésitations explicitées, des craintes dévoilées et affrontées… et, petit à petit l’histoire globale prend une forme cohérente, propre à une action plus « juste ».
Si on suit le déroulement des interactions, on peut alors déceler la logique circulaire de ce processus et de ses conséquences. Par exemple, une pensée (je dois aller chez gens que je ne connais pas), active une réaction émotionnelle de peur intense, cela affecte ma capacité de réflexion, je ressens des signaux de peur dans mon corps, ce qui augmente encore l’intensité de celle-ci, je me sens complètement dépassé et privé de mes capacités d’autonomie, mes symptômes s’amplifient et je suis complètement paralysé… jusqu’à ce qu’on me vienne en aide, que je prenne un médicament, ou que je redevienne progressivement capable de fonctionner à nouveau. Petit à petit, si d’autres expériences se produisent, ce qui risque d’arriver d’autant plus que je commence à les anticiper, je fais un apprentissage secondaire qui active le pattern à la simple évocation d’un élément pertinent de la situation redoutée.
G L : Il s’agit là d’une différence essentielle, me semble-t-il : le thérapeute n’impose pas son point de vue mais part de la réalité de la personne, de sa vision du monde, de son expérience subjective, en ses multiples dimensions.
J-J W : Oui, en fait il traite les patient comme des congénères, je dirais, en leur demandant ce qui ne va pas et en essayant de comprendre où ils sont bloqués. Même si leurs difficultés peuvent sembler bizarres, illogiques, insensées, le pari que nous faisons c’est que, de leur point de vue, ces conduites, ces pensées sont « compréhensibles ».
Je suis tombé sur un article, écrit par un chinois, qui parlait de comprendre et accepter. Cet auteur – Zhao Tingyang - parlait aussi de « dialogue » au sens où nous faisons émerger le sens, où nous co-construisons les choses en échangeant. Il disait que l’important si nous souhaitons envisager une solution commune à un problème, c’est d’abord de commencer à être ouvert à la position de l’autre, à comprendre la manière dont l’autre voit les choses et… à l’accepter ! Et cela, c’est un dialogue stratégique car il y a deux interlocuteurs qui progressent ensemble, vers un objectif commun. Et, du coup, nous avons un socle commun : ton comportement ne me semble pas irrationnel, ou biaisé, ou faux, ou je ne sais quoi… j’en comprends la logique, je vois en quoi il est cohérent par rapport à l’intensité de tes émotions, à ton histoire personnelle, à tes valeurs, à ta souffrance, à tes espoirs… Je peux bien sûr ne pas être d’accord avec ton point de vue, mais j’en reconnais la cohérence et la légitimité.
C’est précisément ce que nous faisons en thérapie. Je me suis donc réapproprié le terme « dialogue », même si je l’ai plus développé dans le sens que je viens de décrire, c’est-à-dire selon ses aspects plus relationnels.
G. L. : Oui, parce qu’il semble que Nardone développe moins cet aspect-là
J-J W : Giorgio a beaucoup parlé de l’importance du langage analogique, de parler au cœur du patient plutôt qu’à son esprit. On connaît l’importance des métaphores, des aphorismes, des histoires, etc., dans le processus d’influence, et nous y accordons une grande attention ainsi qu’à l’aspect « injonctif » des messages, que nous interrogeons aussi. Quel est l’effet que le message produit sur l’autre ? La base cybernétique de notre travail : tenir compte des résultats de ce qu’on fait pour savoir comment poursuivre. Comprendre les « intentions » ou les attentes implicites des patients, en quelque sorte : « Vous dites cela en attendant quoi en retour ? »
Dans un dialogue stratégique, le thérapeute est attentif à discerner ce que le patient attend de ses interactions, et à en questionner la cohérence. Par exemple : « Quand vous vous plaignez à votre femme de son peu d’empressement à faire l’amour, vous attendez d’elle qu’elle en ait plus envie après ? » (rires).
Donc, en lisant cet article, je me suis dit : mais c’est exactement comme ça que je procède dans les entretiens thérapeutiques. Nous savons à quel point les individus tiennent à leur construction du monde – toute leur « santé mentale » en dépend – alors si le thérapeute cherche déjà à imposer ses vues, c’est mal parti ! Essayer de les faire changer d’avis est une tâche gigantesque. Par contre, si on accepte la façon dont le patient voit les choses, alors on peut l’amener à changer lui-même d’avis, et cela c’est bien plus simple. Mais il faut d’abord l’accepter tel qu’il est.
Je trouve donc que le terme de dialogue est plus juste et rend mieux compte de la façon dont se déroulent les entretiens thérapeutiques quand on pratique le modèle systémique et stratégique.
GL : Mais du coup comment arrive-t-on à concilier les points de vue s’ils sont différents ?
J-J W : C’est une bonne question pour les négociations internationales par exemple, mais c’est plus simple pour la thérapie car si les points de vue sont différents le but est commun : le soulagement du patient souhaité ou attendu. Le thérapeute sait que la façon dont le patient voit les choses et y réagit n’est pas la bonne. Pas la bonne tout simplement parce qu’elle ne lui apporte pas l’apaisement. Et il sait que ce qu’il doit faire pour y arriver, c’est arrêter ses tentatives de solution. Le dialogue stratégique va le faire apparaître : « Et quand vous réagissez de cette manière-là, les choses vont-elles mieux après ? » La logique de l’intervention implique que si le patient veut atteindre son objectif, aller mieux, il est donc nécessaire qu’il mette un terme à ses réactions inadéquates. Même les patients soi-disant psychotiques peuvent trouver cette démarche cohérente lorsque le dialogue est bien construit.
GL : Le thérapeute mobilise le patient en lui faisant voir ce qu’il pourrait faire pour aller mieux alors ?
J-J W : Oui, le patient est conduit à réaliser que sa démarche « logique » provoque une aggravation de son état et une dépendance de plus en plus invalidante. Il se trouve devant une configuration différente de son problème, une configuration dans laquelle il est acteur principal, face à la possibilité d’améliorer sa situation s’il change sa façon d’aborder le problème. Parfois il déduit lui-même ce qu’il convient donc qu’il fasse, par exemple : « ah oui, donc vous voulez dire que je dois arrêter de demander de l’aide ? », parfois le thérapeute doit lui suggérer des expériences qui concrétisent le changement de comportement, les tâches.
D’ailleurs, ce positionnement est important pour la relation thérapeutique. Pourquoi voudrais-je, moi thérapeute, qu’il change de façon de vivre s’il en est satisfait ? Lui-même sait plus ou moins consciemment, qu’il lui faudra changer des choses pour se sentir mieux.
GL : On voit qu’au cours du processus, le thérapeute joue d’une certaine manière de lui-même.
J-J W : Oui, c’est même indispensable de jouer de soi, je dirais. Il est vrai que lorsque nous échangeons avec le patient, nous sommes touchés émotionnellement par ce qu’il dit, cela résonne en nous et évoque, dans notre esprit, des images, des métaphores, des expériences vécues ou lues ou entendues, etc., ce qui alimente l’échange, renforce la relation, et prépare le patient à suivre les prescriptions qui viennent alors conclure « logiquement » l’échange. Et plus le thérapeute a de l’expérience, plus il a intégré son modèle thérapeutique, plus la conversation est « libre » d’objectif précis, moins on doit réfléchir à ce qu’il « faut » dire, à quelle métaphore on pourrait utiliser, quel recadrage fulgurant pourrait être décisif, quel argument pourrait faire basculer la décision à prendre, etc., plus l’imaginaire sera riche et adéquat, plus la conversation sera authentique, et… meilleure sera la relation. C’est pour cela que l’empathie est essentielle dans cette histoire. L’idée, c’est quand même de ressentir tout en gardant ce recul indispensable à notre intervention.
GL : User d’une empathie stratégique en quelque sorte. Une intervention qui pourrait s’apparenter à une sorte de plongée anthropologique dans l’univers de la personne, pour s’en imprégner mais sans y adhérer.
J-J. W : Oui, on peut dire ça comme ça.
GL : Et du coup, ton intervention consiste à lui donner du sens à son comportement ? A permettre au patient d’appréhender quelque chose qu’il n’avait pas perçu ?
J-J W : Oui, c’est ce que j’ai appelé « la cohérence interne de l’équilibre dysfonctionnel ». Le thérapeute doit être capable de reformuler, d’une façon narrative, comment une chose en entraine une autre, et finalement de faire apparaître la logique implicite du problème et ses conséquences interactionnelles, comportementales, émotionnelles, cognitives… C’est ainsi qu’il donne à son interlocuteur la sensation d’être complètement entendu et compris, et qu’il l’éclaire aussi sur son propre comportement…
Cette reformulation générale du problème plante le cadre de la thérapie et sera la référence pour l’avancée du travail : les tâches, les recadrages, les commentaires, etc. seront toujours en cohérence avec la trame générale qui est impliquée par la reformulation.
Par exemple, une dame vient me voir avec son fils adoptif de 20 ans. Elle est désespérée parce qu’alors qu’il a un QI de 150, il a arrêté l’école, s’est mis à fréquenter les gens de la nuit, veut gagner beaucoup d’argent, cherche des places de serveur dans des restaurants ou des brasseries chic mais il se fait virer rapidement. Il a tellement volé d’argent à sa mère que celle-ci a décidé de lui payer la location d’un petit studio pour qu’il soit obligé de se responsabiliser. Lui se met de plus en plus en danger, contracte des dettes auprès de connaissances qu’il a peur de croiser par la suite… Il va de plus en plus mal, ne sort presque plus, mais continue à prétendre qu’il est sur un gros projet, avec des gens connus, ou des amis qui vont monter une start-up qui va cartonner, et que tout va s’arranger bientôt… La mère a essayé de l’envoyer en thérapie de nombreuses fois mais ça ne l’intéresse pas. Après notre entretien à 3, il dit à sa mère que j’ai l’air de savoir ce que je dis. Du coup, elle me demande si je peux lui envoyer un mail pour lui demander s’il souhaite qu’on puisse faire un travail ensemble. Comme je suis désolé de voir ce jeune homme plein de vie, de potentiel, capable de réussir une vie passionnante, partir dans une nasse qui se resserre de plus en plus, je décide de lui envoyer un mail. Je lui dis, entre autres choses : Mon impression, c’est que tu as tellement peur de ne pas y arriver que tu te sabotes toi-même. Tu imagines de beaux projets, mais j’ai l’impression que, quelque part au fond de toi, tu es persuadé que tu n’y arriveras pas. Alors, tu essaies de te rassurer toi-même en en parlant aux autres mais tout cela ne réussit pas à te donner la force et le courage de faire ce qu’il faudrait faire pour réussir à les réaliser. Tu es bien coincé. Bon, il y a des moyens de sortir de là, mais je sais qu’on n’entame une démarche de thérapie que si on en a vraiment le désir, donc à toi de voir si tu as envie de discuter de tout ça avec moi. » Et il me répond : « Pour répondre à votre mail, je vois que vous me cernez très bien et que pour moi ça serait un plaisir de continuer à travailler sur moi avec vous. »
En tout cas, le cadre est posé, on sait à quoi on va travailler et le dialogue stratégique consistera à utiliser cette modélisation de son problème pour lui suggérer des issues possibles. Mon impression, c’est qu’il y a cette « croyance » prophétique qui le pétrifie lorsqu’il doit concrétiser ses projets, que cela soit une trace ou non de son passé d’abandon, et qui l’oblige à se replonger dans un autre projet qui s’autodétruit aussi vite, etc. Peut-être avec un comme si paradoxal : « Et si cette croyance était vraie, que ferais-tu de ta vie ? »
Mais pour revenir à notre thème, le dialogue paradoxal a permis de créer la relation en séance, le jeune homme s’est senti compris, et le mail de reformulation peut servir de plateforme au travail.
GL : Qu’est-ce qui, du coup, fait selon toi une différence entre un bon thérapeute et un mauvais thérapeute ?
J-J W : Pas simple comme question parce que la question de l’efficacité est liée aux prémisses de chaque approche thérapeutique, je ne peux donc parler que de ce que nous considérons comme des interventions réussies ou pas. Ce n’est pas toujours à la fin d’un entretien qu’on peut savoir si l’on a été « bon ». Parce que tu peux faire un excellent premier entretien - excellent dans le sens où la personne est très contente de l’entretien et te dit : « cet entretien m’a fait beaucoup de bien » - et… être un mauvais thérapeute en fait. Faire un bon premier entretien à la satisfaction du client n’est pas forcément la garantie d’être un bon thérapeute. Car tu peux être un thérapeute qui flatte le patient, qui lui donne l’illusion qu’il pourra peut-être changer. Ou encore être un thérapeute philosophe qui donne des pistes intellectuelles. Beaucoup de ce qui est reproché aux thérapeutes lorsque l’on dit qu’ils ne sont pas bons, c’est qu’au final il n’y a rien qui change. Et que donc assez vite, ça tourne en boucle, qu’aucune aide concrète n’est apportée à la personne. Mais souvent, ce phénomène dont j’ai parlé plus haut interfère ; cette idée que, progressivement, on s’approche de la clé du mystère… C’est un processus sans fin : plus on avance, plus on sent qu’il manque quelque chose… et donc on continue encore et encore à chercher « sous le réverbère » comme dirait Paul Watzlawick.
GL : C’est donc l’utilité, l’efficacité et donc la stratégie qui prime.
J-J W : Oui, le soulagement de la souffrance. C’est le postulat de Watzlawick au sujet de la psychothérapie : soulager la souffrance. C’est ça qui doit être notre ligne de conduite.
GL : Mais toi qui parlait de ce plaisir si particulier du premier entretien, as-tu aussi ce souci d’être très rapidement efficace ?
J-J W : Oui, c’est primordial pour moi. Dans mon milieu familial, on ne valorisait pas les fulgurances intellectuelles, on s’en méfiait. C’est de la frime ou du solide ? Si c’est du solide, ça doit nous aider à mieux vivre. Je veux dire par là que j’ai le souci d’être payé pour le service rendu et que je suis donc très mal à l’aise quand ça ne bouge pas. Des fois, cela m’amène à prendre des risques. J’ai ainsi un patient à Paris, un intellectuel, malheureux comme les pierres et dans un évitement terrible. Cela fait des années qu’il ne regarde plus son compte en banque. Il n’ouvre plus son courrier. Il est dans un évitement complet. Et donc il vient me voir pour ça. Mais comme il est dans l’évitement, il s’arrange pour éviter que j’aborde les sujets épineux. Et donc il meuble, il meuble, il parle, il parle comme s’il était en psychanalyse. Et donc je lui donne des tâches… qu’il ne fait pas, et il continue à parler. L’avant-dernière fois qu’il vient, il me dit : « Je n’ai toujours pas réglé mes problèmes administratifs ». Et donc il est anxieux avec ça. Et je lui dis « ok, je ne vais plus vous demander de faire des choses puisque manifestement vous n’arrivez pas à les faire ». Il veut donc me payer à la fin de la séance et là je lui dis : « non, je ne peux pas vous laisser me payer puisque mon travail consiste à ce que vous regardiez vos comptes, or, c’est ce que vous n’avez pas encore réussi à faire. Je ne peux donc pas accepter votre argent ». Du coup, il était complètement déstabilisé. Mais immédiatement après la séance il est allé voir ses comptes et était déjà très soulagé. Il revient en me disant : « Là, quand même, vous m’avez bien eu ». Je lui ai créé une dette et il ne voulait pas revenir pour une autre séance gratuite. Bon, je ne recommande pas ça aux apprentis thérapeutes, c’est un peu dingue comme réaction, mais, dans ce cas précis, ça a été bien utile et a permis de débloquer la situation.

GL : Tu l’as fait sciemment ?
J-J W : Je ne peux pas dire que c’était une stratégie planifiée, c’est sûr. C’était plus intuitif si tu veux. Mais je n’aime pas trop ça quand les choses ne bougent pas, et lui est un homme sensible, il me rend impuissant, alors… je sais pas, quelque part, j’ai dû sentir que cela pourrait avoir un impact sur lui. J’aime pouvoir rendre le service que les patients attendent de moi. Même s’il faut reconnaître que l’on ne peut pas réussir à chaque fois. Mais je pense qu’il est fondamental que les thérapeutes aient ce souci d’efficacité, d’utilité. Nous sommes censés soulager les personnes de leur souffrance psychologique. Cela doit être notre ambition en tout cas, c’est la définition même de notre travail.
Je suis d’accord, on ne peut jamais garantir le résultat, mais quand même, j’ai l’impression que le thérapeute doit assumer sa part de responsabilité dans le processus thérapeutique.
GL : Il faut qu’il y ait un résultat, un effet…
J-J W : Un effet positif et un soulagement significatif par rapport à leur problème, durable de préférence.
GL : Weakland disait qu’être un bon thérapeute, c’était savoir écouter et oser intervenir. Tu dirais pareil ?
J-J W : Savoir écouter et oser intervenir, sûrement. Je trouve que c’est une belle formule. Ecouter, comprendre, et oser agir. N’oublions pas non plus le côté auto-correcteur, cybernétique en fait, du dialogue ; le thérapeute peut se tromper, reformuler d’une façon que le patient semble accepter, et lui donner des tâches qui sont à côté de la plaque. On sait que le thérapeute doit tenir compte du retour des tâches, mais en fait ce processus autocorrecteur commence dès le début de l’entretien, dès les premières questions. C’est petit à petit que le pattern dysfonctionnel apparaît, le thérapeute n’est pas censé avoir la science infuse, le feed-back est capital tout le long, c’est cela qui permet la construction du DOSS, c’est toute la substance du dialogue stratégique.
Je souhaiterais conclure en citant cette phrase de Lin Yutang que j’aime beaucoup et qui traduit bien mon sentiment à l’égard de la vie en générale et de ce que nous faisons en thérapie me semble-t-il : « Aucun souci de perfection, aucune poursuite de l’inaccessible, aucune recherche de l’inconnaissable; mais, prenant la pauvre nature humaine telle qu’elle est, comment nous organiser pour pouvoir travailler paisiblement, souffrir noblement et vivre heureux? »
Intéressé ? Envie d’en connaître plus ? Ceci est pour vous :
La force principale du modèle de Palo Alto, c’est qu’il propose une méthode, une méthode de résolution de problèmes personnels et relationnels, une méthode identique quel que soit le contexte dans lequel ce problème se manifeste. Cette méthode permet de comprendre la façon dont les problèmes « fonctionnent », d’en saisir la « logique », et, du coup, de pouvoir élaborer une stratégie de changement efficace et réaliste et de créer un contexte relationnel de confiance qui incite le patient (ou le client) à suivre les prescriptions suggérées par l’intervenant.
C’est cela qui attire tous les participants qui ont déjà suivi des formations telles que PNL, hypnose éricksonienne, pleine conscience, thérapies orientées solutions, sophrologie, etc. Ils ont le sentiment de pouvoir situer leurs acquis dans un cadre global cohérent.
Alors, si vous souhaitez être initié de façon rigoureuse et étayée à l’approche systémique et stratégique par un praticien confirmé, et selon le domaine qui est le vôtre, nous vous proposons :
Initiation à la thérapie systémique et stratégique (2 ou 3 journées animées par J.-J. Wittezaele)
[ Menu ]
Santé mentale
1. La thérapie systémique et stratégique
Voici un nouvel article de Jean-Jacques Wittezaele qui vient de paraître aux Editions deBoeck/Supérieur, dans les Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, N°60, sur le thème : « Les singularités du thérapeute ».
Portrait d’un thérapeute en quête d’humanité
Comment repérer soi-même ses propres singularités, comment distinguer soi-même ce qui nous différencie des autres ? Face à ce paradoxe capable de paralyser un mille-pattes et le laisser dans les affres de ses réflexions introspectives, seul le baron de Müncchausen aurait pu s’en sortir en recourant à l’un de ses tours de force légendaires … Aussi, plutôt que d’essayer vainement de définir qui je suis, j’ai choisi de raconter quelques épisodes marquants de ma vie et d’évoquer les rencontres déterminantes qui m’ont conduit vers ce métier de psychothérapeute. J’aborderai alors la façon dont je conçois ce travail, comment je pense l’exercer, et ce qu’il m’apporte, en insistant sur le style d’interaction que je cherche à établir avec mes patients. Je laisserai au lecteur le soin d’en tirer ses propres conclusions et d’en dégager ce qui lui paraît singulier.
Ma vie avant Palo Alto
On ne peut pas dire que j’aie eu la vocation… Si j’avais eu un meilleur professeur de chimie et de physique durant mes études secondaires, c’est la biologie qui aurait fait l’objet de mon choix de parcours universitaire. Mais bon, il fallait bien choisir quelque chose si je ne voulais pas me retrouver à devoir faire toute ma vie un quelconque métier pour lequel je n’éprouvais guère plus d’intérêt de toute façon. Alors j’ai choisi la psycho. En cherchant bien, on pouvait déceler un certain lien de parenté avec la biologie, même si je ne me suis rendu compte que bien plus tard de l’importance des liens entre le corps et l’esprit.
J’ai fait mes études à l’époque de l’antipsychiatrie. Laing et Cooper dénonçaient la violence exercée sur les internés, Ken Loach nous initiait à l’écologie familiale (5), Bob Dylan nous assurait que les temps allaient changer et la mode était au politiquement incorrect. J’ai été révolté, comme tant d’autres, par le film Vol au-dessus d’un nid de coucous(6) qui dénonçait l’inhumanité de certains traitements psychiatriques. Mais c’était plus l’expression de l’indignation aveugle de la jeunesse que le fruit d’une réflexion rationnelle argumentée: nous refusions des pratiques jugées inhumaines ou irrespectueuses (« Pour qui prenait-on ces gens ? De quel droit, au nom de quoi pouvions-nous leur imposer des traitements pour leur bien sans se soucier de leur propre désir ? Mais pour qui nous prenions-nous ? ») mais n’avions pour solution que des belles idées bien vagues et marginales pour soulager les patients. Nous nous battions contre l’oppresseur mais nous étions bien démunis face à la souffrance des aliénés. Bien qu’une partie de moi applaudissait à ces efforts courageux, j’étais gêné par le romantisme quasi suicidaire de ce mouvement antipsychiatrique engagé… Ouvrir les asiles ne pourrait seul permettre aux patients d’aller mieux. Mais que proposer alors ?
Si la psychiatrie luttait contre les symptômes, parfois au mépris du patient, la psychologie pouvait-elle offrir une alternative plus acceptable, et plus efficace ?
On le sait, l’université est toujours à la traîne, et ce que j’y ai appris ne m’a pas vraiment séduit. Les théories freudiennes et les interprétations du comportement humain qu’elles proposaient me semblaient maniées par des « initiés » un peu sadiques, sorte de justiciers culpabilisants qui jouaient de leur prétendue connaissance des arcanes de l’inconscient pour réduire leurs adversaires à l’impuissance à coups de jeux d’esprit réflexifs ponctués d’œillades entendues aux membres de leur caste. Véritables conquistadors de l’esprit humain, ils apportaient la bonne parole aux ignorants, faisaient et défaisaient les réputations, imprégnaient les arts et les lettres, imposaient leurs principes moraux, toujours prêts à juger du bien et du mal, à condamner ou à sauver au nom de la Vérité Analytique. Cette prétention m’a toujours exaspéré, on l’aura compris.
Et puis, j’ai découvert la psychologie expérimentale, les programmes de conditionnement, les animaux de laboratoire. La rigueur théorique de l’approche me plaisait, et j’ai été fasciné par la capacité d’apprentissage des chats, des rats et même des humains : nous sommes capables de faire tant de choses que nous ignorons savoir faire. En travaillant avec les chats, j’ai découvert que les résultats des apprentissages dépendaient beaucoup de la façon dont les traitaient les expérimentateurs. Mal m’en prit, mon professeur traita avec dédain mes commentaires relationnels et contextuels et cela marqua la fin de mes recherches expérimentales animalières. Finalement, c’est la psychologie sociale qui m’apporta un peu de réconfort et me permis de m’initier au changement de comportement et aux groupes de développement personnel, un premier pas vers la thérapie, bien que ces pratiques de groupe m’aient toujours semblées naïves, parfois hypocrites et souvent superficielles tout en encourageant des attentes utopiques chez les participants. Ces petites rencontres éphémères, hors du temps, abolissant les statuts sociaux, formaient des espèces de creusets sociaux expérimentaux qui ont alimenté bien des espoirs et précipité bien des désillusions.
Arrivé à ce stade de mon récit, le lecteur arrivera sans doute à la conclusion qu’une des singularités de l’auteur, c’est d’être un bel emmerdeur ! Jamais content, toujours quelque chose à critiquer, tendance à gâcher le plaisir… Certes, je ne peux cacher une certaine irritation face à ces pratiques que je juge trop absolutistes, ou opportunistes, ou encore trop « expérimentales » et naïves. Néanmoins, un petit retour sur mon enfance permettra peut-être d’éclairer sinon de justifier cette attitude critique.
Des fondations pragmatiques
On sait à quel point le milieu d’origine donne la couche de fond à notre relation au monde. Mon beau-père ayant choisi de reprendre à son compte une jeune veuve et ses cinq garçons, il a dû mettre un peu de réalisme dans ses idéaux communistes : à la maison, on ne pouvait pas se permettre de longues grèves de métallos, il fallait assurer la pitance pour tous et ma mère y veillait. Comme j’étais le plus jeune de la tribu, j’ai eu la chance d’échapper à la pression du besoin d’argent (les aînés devaient trouver du travail dès la fin de l’obligation scolaire - on ne rigolait pas tous les jours en ce temps-là). Mais j’avais déjà conscience de ce qui m’attendait si mes résultats n’étaient pas bons. Un jour, l’instit de 2e primaire a amené une musette d’ouvrier à l’école, il l’a montrée à la classe en disant : « Vous voyez, si vous ne travaillez pas bien, c’est ça qui vous attend… comme tous les ouvriers de la briqueterie ». Là, je me souviens avoir pensé : « Ah ça non, tout mais pas la briqueterie ! » et l’année suivante je sautais une classe et j’ai donc fait « des grandes études ». Fiers d’avoir un enfant qui avait de bons résultats scolaires, mes parents n’étaient pas prêts pour autant à renoncer à leur pragmatisme salutaire. Quand on me demandait de raconter ce que j’apprenais, pas question de poudre aux yeux : il fallait expliquer avec des mots compréhensibles et surtout montrer à quoi cela pouvait servir ! J’en ai gardé une ligne de conduite pour toute ma carrière de thérapeute : le souci de l’efficacité, des résultats tangibles, et une grande méfiance vis-à-vis des explications, des analyses, des interprétations un peu condescendantes qui servent souvent à noyer le poisson.
Donc voilà comment je me retrouve à la fin de mes études de psychologie : rebuté par les traitements psychiatriques et la psychanalyse, sceptique face aux thérapies comportementales sans âme, et échaudé par les approches humanistes naïvement angéliques. D’un point de vue professionnel, on peut dire que je me situe plus ou moins au beau milieu de nulle part !
Mes centres d’intérêt sont tout autres : les cinéclubs, les vernissages d’expositions, les expérimentations d’autres états de conscience, la littérature, la peinture (que je pratique à l’époque), la philosophie orientale… bref un système chaotique ouvert sur son environnement mais bien loin d’une position d’équilibre !
Les jeunes, leurs familles et… la terre promise
Mais il faut bien gagner sa vie, et je trouve donc un emploi dans la Protection de la jeunesse. Le secteur est lui aussi en pleine effervescence et à la recherche de méthodes pour professionnaliser les actions d’aide aux jeunes en difficulté. Que faut-il faire avec ces enfants maltraités, avec ces ados en révolte? Les aider ou en protéger la société ? Au service de qui sommes-nous finalement et quel objectif notre travail doit-il poursuivre ? Et puis ces jeunes ont des familles, alors au lieu de les ignorer ou de les écarter de notre action ne faudrait-il pas plutôt les aider à poursuivre leur mission naturelle d’éducation de leurs enfants ? L’idée est belle et prometteuse, mais il y a un sérieux obstacle: comment faire ? Comment aider les jeunes et leur famille à dépasser leurs difficultés ?
Toutes ces questions ont été déterminantes parce qu’elles ont orienté mes recherches vers les thérapies familiales. Je n’y connaissais rien à l’époque, et pénétrer dans ce territoire était aussi stimulant que partir explorer des terres inconnues. Tel Stanley revenant du Congo, Mony Elkaïm nous rapportait déjà des documents sur les familles des ghettos new-yorkais et nous initiait aux paradoxes. Les rayons de thérapie familiale étaient encore bien maigres dans les librairies. Je me souviens de l’impact du premier livre que j’ai lu sur le sujet : Nouvelles stratégies en thérapie familiale (7), de Jay Haley. Sûr de lui, provocateur, ce dernier avait travaillé pendant des années dans un institut célèbre de Palo Alto, le Mental Research Institute (MRI) et il parlait déjà de stratégies concrètes de changement. Enfin quelque chose qui me parlait.
Un nouveau monde s’est ouvert devant moi à la lecture de Changements – Paradoxes et psychothérapie (8), mon premier contact avec la « thérapie brève de Palo Alto ». Il m’est difficile aujourd’hui de décrire ce moment de bifurcation qui a bouleversé ma vie. Je trouvais enfin ce que j’avais toujours cherché sans pouvoir le définir. Une approche pragmatique, non normative, qui refusait les étiquettes pathologiques, des actes plus que des paroles, des techniques efficaces… Et puis il y en avait aussi pour l’esprit et le cœur du jeune adulte avide de sensations et de sens que j’étais alors: Bateson avait côtoyé Alan Watts qui lui-même avait introduit le bouddhisme zen en occident, il avait vécu à Big Sur, haut lieu de la Beat Generation, repère d’Henri Miller… Don Jackson avait viré son divan de psychanalyste et créé le MRI, Dick Fisch ironisait sur le DSM bis, John Weakland parlait d’Erickson et laissait entendre qu’il aurait servi de modèle au sorcier Yaqui raconté par Carlos Castaneda… Chaque jour je découvrais d’autres liens, d’autres signes de la terre promise que je n’avais jamais osé imaginer dans mes rêves les plus fous! Comment toutes les idées qui m’avaient stimulé jusque là, les poussées de révolte qui n’avaient pas encore trouvé leur juste expression, l’espoir de découvrir ce qui donnerait enfin une direction à ma vie, comment tout cela s’est miraculeusement concrétisé pour prendre une forme qui m’allait comme un gant. J’avais enfin trouvé la tribu à laquelle j’appartenais. Je n’eus plus qu’un seul désir : aller là-bas, aller « chez moi » pour apprendre à faire de la thérapie brève…
La thérapie brève
Je garde encore en mémoire cette première séance au Centre de thérapie brève au début des années 1980, aux côtés de Paul Watzlawick et de John Weakland, regardant Dick Fisch conduire un entretien derrière la glace sans tain. Ah, on ne trichait pas là-bas, on montrait ce que l’on faisait et on enregistrait les séances. Rassurant pour moi, bien sûr ; je trouvais cela non seulement courageux mais aussi respectueux et professionnel car la transparence était le gage d’un travail sérieux, et j’aimais l’idée qu’un travail thérapeutique ne devait pas être une sorte de pratique occulte, obligatoirement secrète, mais une série d’actes techniques dans un contexte relationnel orienté vers le changement, c’est-à-dire vers l’arrêt de la souffrance du patient. J’ai beaucoup appris en les regardant travailler et en échangeant avec eux sur les séances ; j’essayais de comprendre comment ils progressaient, comment ils pensaient, ce qu’ils ressentaient, à quelles difficultés ils étaient confrontés, mais ce qui me fascinait vraiment c’était de les voir à l’œuvre, avec cette tension de l’échange en direct jusqu’à la conclusion parfois déconcertante de la tâche finale, cette forme de suspense créatif au charme insurpassable.
Leur façon de concevoir la thérapie me semblait limpide. Selon John Weakland, « la vie est une suite de difficultés, un problème est la même difficulté qui revient sans cesse. Si elle revient, c’est que la façon dont nous y avons réagi n’a pas permis de trouver une solution satisfaisante. » C’est donc à ce niveau que l’on peut agir : si une personne n’arrive pas à mettre un terme à l’inconfort ou à la souffrance, c’est que les moyens qu’elle déploie pour ce faire ne sont pas adéquats. Ce sont ces efforts infructueux pour trouver le soulagement que l’école de Palo Alto appelle les « tentatives de solution » : elle considère que le premier travail du thérapeute consiste à mettre un terme à ce processus dysfonctionnel.
La cible du traitement devient donc l’arrêt des tentatives de solution qui, au lieu de permettre une disparition du problème, enveniment la situation par un processus d’amplification de la difficulté. Il n’est dès lors plus nécessaire de recourir à une vision normative des difficultés psychologiques mais de suivre le patient dans son désir d’évolution. De plus, et c’est sans doute là l’aspect le plus révolutionnaire de l’approche, le thérapeute ne doit pas savoir ce qui est bon ou non pour son patient dans l’absolu : ce sont les efforts inefficaces du patient lui-même qui indiquent, par un virage à 180 degrés, la voie de la solution. Le thérapeute n’est plus le gardien de l’ordre moral ou de la normalité, il devient agent de changement au service de son patient.
L’objectif du psychothérapeute apparaît donc clairement : il va utiliser toutes les ressources de la communication pour que son patient renonce à ses tentatives de solution de sorte que les interactions concernées puissent se réguler efficacement. Il s’agit, pour le thérapeute, de trouver les meilleures techniques et stratégies de communication pour y parvenir, introduire des grains de sable et enrayer le cercle vicieux, en sachant que, la plupart du temps, tous les apprentissages antérieurs et la construction du monde du patient le poussent à persister dans ses tentatives de solution.
Les vrais choix sont les choix du cœur, on le sait, et c’est véritablement un coup de foudre que j’ai éprouvé pour la thérapie brève de Palo Alto. L’efficacité et le pragmatisme du modèle me paraissaient des valeurs plus sûres que les promesses utopiques d’épanouissement personnel, de connaissance de soi voire d’illumination du mouvement pour le potentiel humain, et moins dégradants que la soumission à la norme ou la socialisation forcée à grands coups de psychotropes. J’ai toujours trouvé que la thérapie ne doit pas laisser croire que l’on peut être heureux en s’évadant du monde, que ce soit par la prière, la méditation, ou n’importe quelle autre technique psychologique, et qu’il importe de ne pas détourner l’attention des patients de « l’implacable mécanique du monde (9) », selon la formule de Colson Whitehead. La thérapie ne doit pas rendre heureux, elle doit donner ou redonner aux patients les moyens de surmonter les difficultés inévitables du quotidien pour pouvoir profiter de la vie. Comme on le voit, je défends une philosophie pragmatique aux relents taoïstes : « Aucun souci de perfection, aucune poursuite de l’inaccessible, aucune recherche de l’inconnaissable; mais, prenant la pauvre nature humaine telle qu’elle est, comment nous organiser pour pouvoir travailler paisiblement, souffrir noblement et vivre heureux? (10) » Cette citation traduit vraiment au plus près le projet qui guide mon travail thérapeutique.
Les doutes et le renouveau
On peut sans doute me considérer comme un « thérapeute militant ». J’ai passé ma vie professionnelle à montrer qu’on pouvait soulager les troubles mentaux sans réduire les patients à leurs symptômes, sans les traiter comme s’ils ne faisaient plus vraiment partie de la même espèce que les autres, comme s’ils devaient avoir des caractéristiques différentes de la normale, comme s’il leur manquait une partie essentielle de notre humanité.
Je revendique mon appartenance à la famille systémique, je suis profondément batesonien et je ne crois donc pas aux explications biochimiques des troubles mentaux. Mon sentiment, c’est que la psychiatrie a perdu son âme en acceptant le défi sécuritaire proposé par les autorités politiques et judiciaires. Pour moi, les médicaments peuvent sans doute calmer les angoisses, apaiser les délires paranos, mais certainement pas soigner les troubles psychiques.
Je pense que la recherche des agents responsables des troubles psychiques s’est égarée, et ce pour des raisons épistémologiques. Je pense en effet que la « métaphore médicale » a mystifié les chercheurs en les orientant vers des dysfonctionnements du cerveau, plutôt qu’en osant aborder de front ce phénomène très particulier qu’on appelle « l’esprit humain ». Nous pourrons identifier des types de configurations de Perception/Réaction rendant compte des différentes formes de troubles mentaux, disposer de stratégies et techniques communicationnelles pour les traiter et concevoir une alternative interactionnelle à la classification des pathologies du DSM (11).
Mais j’ai traversé de grands moments de doute…
Permettez-moi d’évoquer une histoire personnelle. Il y a une situation qui m’a beaucoup marquée à mes débuts de thérapeute bref de Palo Alto. Un de mes amis m’avait adressé une femme d’une trentaine d’années, mariée, deux enfants en bas âge ; elle était dans un état de souffrance insupportable. Elle « devait » trouver des synonymes à des mots qui étaient prononcés dans la conversation ou qu’elle-même lisait ou entendait par hasard. Sinon l’angoisse était extrême. Elle interpellait son mari sans arrêt, téléphonait à ses amies en pleine nuit pour leur demander de l’aider à trouver des synonymes… C’était pareil pendant les séances et c’était une torture pour moi aussi. Je n’avais guère d’expérience de ce type de problème, et j’étais complètement incapable de trouver ses tentatives de solution. Du coup, je ne comprenais plus rien à son problème. Elle ne « faisait » rien pour y mettre un terme, tout simplement parce qu’elle n’avait aucun contrôle sur ces compulsions qui la rendaient folle. Je vous assure qu’il n’était pas besoin de vouloir l’aider ; tout son être me suppliait de la sortir de là. Mais même si je l’avais voulu, je ne savais pas comment elle pouvait faire pour en sortir. Si « ne rien faire » est la tentative de solution, alors il faut faire quelque chose… Mais quoi ? Je me suis longtemps bien inquiété pour elle mais après 5 ou 6 séances, je redoutais de la voir parce que je me sentais impuissant à l’aider. J’ai donc arrêté la thérapie sans vraiment être sûr de l’orienter vers quelqu’un qui pourrait lui apporter l’aide qu’elle recherchait… Je ne savais pas à qui l’adresser. (Aujourd’hui, je saurais !)
J’ai appris, par l’ami qui me l’avait envoyée, qu’elle avait été hospitalisée, avait perdu la garde de ses enfants qui avaient été confiés à son mari, celui-ci avait demandé le divorce justement parce qu’il craignait pour la santé des enfants. Deux ans plus tard j’ai reçu d’autres nouvelles : elle s’était suicidée. Fin de l’histoire. Cela m’a beaucoup marqué. Et j’ai mis longtemps à vraiment m’en remettre. Cela a créé un grand doute quant à mes compétences en tant que thérapeute. Cette question du traitement des TOC demeure une référence de « sérieux » pour moi : que fait-on pour aider une personne qui a des compulsions, qui est prise dans un engrenage infernal qui lui envahit la vie comme un cancer ?
J’ai un jour eu l’occasion de poser la question à un grand thérapeute réputé pour sa posture tendant au non vouloir, à l’attente de l’éclosion d’une solution par une co-évolution des entretiens thérapeutiques. « Lorsque vous vous trouvez face à quelqu’un qui se trouve complètement incapable de sortir de ces schémas répétitifs invalidants, que faites-vous ? » lui ai-je demandé. La réponse m’a à la fois amusé et choqué: « je l’adresse à un confrère ».
Le concept de tentatives de solution nous orientait surtout vers la recherche de comportements intentionnels et mésestimait, de mon point de vue, les aspects souvent irrationnels des conduites humaines.
La rencontre avec Giorgio Nardone a marqué une nette évolution de mon travail. D’abord parce qu’il a élargi le concept de tentatives de solution en y incluant des réactions involontaires (émotionnelles notamment), parce qu’il a pu repérer des patterns de tentatives de solution semblables pour différents grands types de troubles, et ensuite parce qu’il a mis au point des stratagèmes précis pour les traiter, avec un taux d’efficacité impressionnant. De plus, le concept de « système de perception/réaction », interface dynamique entre l’individu et son milieu, a permis d’intégrer les visions systémique et constructiviste, et de donner une vision à la fois globale et différenciée des diverses composantes des tentatives de solution (la « perception » incluant les aspects interactionnels, comportementaux, les sensations de base et les émotions, ainsi que la pensée réflexive et l’imagination).
Si la rencontre avec l’équipe du MRI a été déterminante pour ma carrière professionnelle, c’est la collaboration avec Giorgio Nardone qui m’a permis de devenir un meilleur thérapeute, à chercher sans cesse à améliorer mon travail, à établir des distinctions plus pertinentes entre les différents types de problématiques, à acquérir un savoir-faire technique de plus en plus pointu et différencié, tout en m’autorisant de plus en plus à ressentir autant qu’à comprendre ce qui se passe durant les séances de thérapie.
Nous exerçons un métier. Un métier un peu particulier peut-être, mais un métier quand même. Et ce métier, comme tous les métiers, demande du savoir-faire et je pense vraiment que si l’on insiste autant sur le savoir-être, dans notre profession, c’est aussi parfois parce qu’on y manque cruellement de savoir-faire technique.
Giorgio Nardone a aussi décidé de rompre avec le tabou de l’usage des étiquettes psychopathologiques, ce qui lui a permis de montrer comment le modèle de thérapie brève stratégique ainsi revisité permettait de traiter les patients correspondant aux grandes catégories du DSM. Cela a provoqué un tollé dans le milieu des thérapeutes se revendiquant de Palo Alto. Certains ont crié à la trahison, d’autres ont carrément ignoré les évolutions du modèle … Pour ma part, j’ai considéré qu’il s’agissait d’une évolution capitale qui m’a permis de poursuivre mon projet d’alternative interactionnelle à l’approche médicale avec une confiance renouvelée.
J’ai toujours eu l’âme d’un chercheur et ma collaboration avec Giorgio Nardone a ranimé le rêve qu’avait suscité ma rencontre avec l’équipe du MRI : proposer une méthode thérapeutique souple, respectueuse de la réalité du patient, responsabilisante, basée sur l’utilisation de ses ressources et tenant compte de son écologie relationnelle ; une méthode efficace, pouvant afficher ses résultats, donc capable de constituer une véritable alternative communicationnelle à l’approche médicale et médicamenteuse des troubles psychiques.
Les allers et retours entre le terrain et la conceptualisation ont permis de faire émerger, petit à petit, non seulement un « modèle revisité » mais, au-delà, une « logique » à la fois du fonctionnement et de la résolution des troubles mentaux (étiquetés ou non par la psychiatrie), un mode de diagnostic basé non plus sur les caractéristiques personnelles mais sur les interactions entre l’individu et lui-même, les autres, et le monde en général, un diagnostic pragmatique, validé par la résolution des problèmes !
Nous ne cherchons plus à repérer certaines caractéristiques des patients, ni même une série de conduites spécifiques, nous recherchons les « patterns » de perception/réaction dysfonctionnels qui génèrent les symptômes. Les processus interactionnels élémentaires (l’évitement, le contrôle et la validation de croyance) qui permettent à l’individu de s’adapter aux changements incessants de son milieu, peuvent s’emballer et finir par former des systèmes stables mais générateurs de souffrance que l’on appelle des « troubles mentaux ». La perception est un phénomène circulaire et dynamique : la manière dont le patient perçoit son milieu détermine sa façon d’y réagir, et ses réactions déterminent à leur tour sa manière de le percevoir. Notre modèle thérapeutique vise à corriger ces systèmes de perception/réaction stables mais générateurs de souffrance en provoquant, à l’aide d’interventions stratégiques (questions, « recadrages », prescriptions thérapeutiques), des expériences émotionnelles correctrices capables de les déstabiliser et de produire alors un nouvel équilibre plus fonctionnel.
Le diagnostic opératoire systémique et stratégique (DOSS)
Il apparaît que l’évitement, le contrôle ou la confirmation d’une croyance construite au gré de nos expériences sont des réactions courantes et récurrentes dans la vie de chacun. Il nous arrive à tous d’éviter des obstacles, d’anticiper des moyens de contrôle et de définir ce qui nous convient ou pas, est responsable ou pas de nos malaises et de nos joies. Ces moyens de régulation des difficultés ne sont donc pas dysfonctionnels en soi. Comment peuvent-ils le devenir ? Ici encore, notre position est pragmatique : ils sont dysfonctionnels quand ils génèrent des effets non désirables persistants pour la personne qui les utilise dans le contexte où elle le fait. C’est alors que ces moyens de régulation deviennent des « tentatives de solution ». Nous recherchons ces processus interactionnels élémentaires qui dysfonctionnent et qui génèrent les symptômes.
Ces trois types de mouvements initiaux vont se déployer de façon systémique, par un enchaînement circulaire de causes/effets, pour former des configurations dynamiques stables mais dysfonctionnelles. Prenons un exemple : une pensée (« Je dois prendre le train demain ») entraîne une émotion aversive (la peur de faire une attaque de panique) suivie d’une conduite d’évitement (« Je vais prendre un Xanax » ou « Je vais demander à ma mère de me conduire ») qui soulage momentanément (« Ouf, je pourrai aller voir ma copine demain … ») mais finit par créer une dépendance (médicamenteuse ou relationnelle : « …grâce au Xanax » ou « …grâce à ma mère »). Comme la personne n’affronte plus et recourt à chaque fois à la même tentative de solution (chercher la réassurance auprès de quelque chose ou de quelqu’un), elle renforce sa peur de prendre le train et son sentiment d’incapacité à affronter seul ce transport en commun. On le voit, la perception de certains éléments du contexte (un danger, une menace, une attirance, etc.) active alors un pattern de réponses qui ne permet pas le soulagement mais qui, au contraire, constitue la façon dont le problème « fonctionne », c’est-à-dire comment il est entretenu par les différentes tentatives de solution. Pour le patient, son problème c’est la peur de faire une attaque de panique dans le train. Pour le thérapeute stratégique, le problème du patient, c’est le fait que sa peur de faire une attaque de panique est à chaque fois traitée par l’évitement et la demande d’aide, ce qui l’empêche d’affronter lui-même la situation redoutée et… de découvrir qu’il peut ne pas en faire (ce qui constituerait une expérience émotionnelle correctrice).
Le thérapeute va donc imaginer un recadrage rendant aversifs l’évitement (« La peur qu’on évite se transforme en panique, la peur qu’on affronte se transforme en courage ») et la demande d’aide (« Je sais que pour le moment vous ne pouvez pas vous en passer mais gardez à l’esprit que, à chaque fois que vous demandez l’aide de votre mère ou que vous prenez un médicament, vous aggravez le problème ». Le thérapeute devra également imaginer une tâche qui permettra au patient de réagir d’une façon différente lorsqu’il se trouvera dans le train : il sait que la réaction de panique se produit parce que le patient, lorsqu’il est anxieux à l’idée même de prendre le train, focalise son attention sur tous les indices physiques (les battements de son cœur, ses difficultés respiratoires, sa transpiration, etc.), ce qui provoque un emballement de sa peur. Le thérapeute va donc imaginer une tâche visant à élargir le champ perceptif de son patient « dès les premiers signes de panique (12)».
Cette classification nous permet ainsi d’approcher les troubles mentaux selon les différents processus de régulation utilisés par les patients et non par rapport à des symptômes ou des pathologies définies. Nous ne cherchons pas à savoir ce qui ne va pas dans sa tête ou son cerveau qui le conduirait à faire des attaques de panique, nous cherchons à savoir comment il les provoque en réagissant de façon inappropriée dans les différentes interactions concernées par le problème : son interaction avec lui-même (la recherche des signes physiques de panique), son interaction avec les autres (demande d’aide dysfonctionnelle) ou avec le monde (aide médicamenteuse, peur de se sentir « emprisonné dans le train »).
Spécificités de la relation thérapeute/patient en thérapie stratégique
C’est sans doute dans la façon dont le thérapeute conduit les entretiens thérapeutiques qu’apparaît l’essence même de l’approche stratégique et que l’on voit émerger le type de relation que le thérapeute veut induire avec son patient, à savoir : « je souhaite comprendre comment vous vivez les choses et ce qui ne vous convient pas ; nous envisagerons ensemble comment vous pourriez vous y prendre pour être soulagé. »
Le mode d’entretien préconisé par le dialogue stratégique est très différent de celui pratiqué par les thérapeutes qui basent leur intervention sur les catégories du DSM par exemple. Ce dernier incite en effet le clinicien à rechercher les signes cliniques susceptibles de déterminer le type de pathologie dont souffre son patient afin de pouvoir lui appliquer le traitement correspondant. Les hypothèses générées par le discours du patient, l’énumération de ses plaintes et/ou symptômes orientent l’intervenant vers diverses catégories possibles du DSM que son questionnement ultérieur cherchera à discriminer. S’agit-il d’un trouble anxieux ? Mais quand le patient fait allusion à des sensations étranges de dépersonnalisation, cela doit-il faire envisager la possibilité d’une schizophrénie ? C’est la nécessité de situer le patient dans une catégorie définie qui constitue l’objectif du questionnement, et détermine donc l’orientation de l’entretien. Cette approche est typique de la méthode scientifique occidentale : le chercheur analyse les données, élabore un modèle d’action et cherche à l’appliquer aux « faits ». Cette méthode soulève énormément de résistance lorsque les « faits » concernent des personnes qui vivent… et réagissent !
Définir quelqu’un, c’est ne lui laisser aucune chance. Aucune chance d’être lui-même, de se sentir libre, d’exister… C’est une condamnation sans appel et irrévocable. Comme le faisait remarquer un patient d’une trentaine d’années étiqueté schizophrène à la suite d’une bouffée délirante à la fin de ses études : « A 20 ans, j’ai pris perpèt’ ».
Avec le dialogue stratégique, nous cherchons à savoir comment les plaintes ou les symptômes sont vécus d’un point de vue relationnel, comportemental, cognitif, émotionnel, physiologique par le patient lui-même. La référence n’est pas « la catégorie à laquelle il appartient » mais l’adhésion du patient à nos reformulations de son problème : le thérapeute a-t-il compris la façon, parfois complexe, dont le patient vit le problème ?
Durant les entretiens, le thérapeute ne cherche pas à étiqueter les problèmes, il cherche plutôt à apprécier les spécificités de chaque situation concrète, en elle-même et pas en référence à des catégories générales. Le thérapeute stratégique n’essaie pas d’imposer son point de vue au patient ; il focalise son attention sur le fait que les réactions du patient face au problème ne lui permettent pas d’atteindre l’objectif qu’il poursuit. Même si le discours du patient va à l’encontre du bon sens ou heurte certaines convictions du thérapeute, celui-ci cherche à comprendre et à accepter le point de vue de son interlocuteur parce qu’il « suppose que les acteurs agissent dans des situations variées, d’une manière qu’eux-mêmes considèrent comme rationnelle et raisonnable. Dans ce contexte, la rationalité signifie que ce que veut dire l’acteur/auteur est généralement en harmonie avec son intentionnalité cognitive et, volitive, mais cette intentionnalité n’est pas pour autant raisonnable ou sensée (13)».
Danse avec le patient
C’est là que se situe le vrai dialogue thérapeutique : nous l’avons vu, à l’histoire que lui amène le patient, histoire qui l’empêche de trouver la solution, le thérapeute va répondre par une « reformulation stratégique », synthèse d’une série de questions qui conduisent le patient à découvrir l’inadéquation des moyens qu’il utilise pour faire face à ce qui le préoccupe et/ou le fait souffrir. L’intervention stratégique se situe justement dans l’attitude paradoxale, la rupture de continuité entre :
- le comportement empathique du thérapeute durant la phase d’élucidation du problème et de verbalisation de la logique de la vision du monde du patient, et
- la proposition stratégique du thérapeute qui marque une conclusion en opposition avec celle du patient. Celle-ci crée une sorte de dissonance cognitive et émotionnelle que le patient doit résoudre en abandonnant ses prémisses inadéquates.
La réaction empathique doit être inhibée à chaque fois que le patient recourt à ses tentatives habituelles pour essayer de résoudre son problème. Une fois calibré sur cette règle du jeu relationnel, le thérapeute pourra, le plus « spontanément » du monde, commenter les tentatives de solution par diverses réactions : regard interrogatif, froncement de sourcils, signe d’étonnement, … et marquer ainsi des failles dans la vision du monde du patient, dans sa « logique » personnelle. Cet étrange aller-retour entre leur monde et le nôtre, les reformulations qui font apparaître cette interface qui nous relie, décoder leur vie à partir de la nôtre en s’assurant qu’on ne les trahit pas, cela crée une sorte de danse interactive entre le patient et le thérapeute, entre les questions qui génèrent des réponses et les réponses qui permettent la construction de nouvelles questions stratégiques. Il conduit le patient à changer sa perception grâce aux découvertes acquises à travers le questionnement stratégique.
Ces ruptures d’empathie stratégiques constituent des moments clés du processus thérapeutique. La « bienveillance » du thérapeute étant ancrée dans le questionnement empathique, ces ruptures créent les conditions d’une double contrainte thérapeutique. Les indications de traitement proposées par le thérapeute, les prescriptions, apparaissent alors comme la « conclusion logique » de cet échange.
J’ai reçu un patient venu consulter parce que, disait-il, « sinon il ne me reste plus que le suicide ». La quarantaine, il se retrouvait complètement isolé socialement et s’était résolu à retourner vivre chez ses parents avec lesquels il était en conflit permanent. Il avait beau leur expliquer qu’il est nécessaire de mener un combat contre « le fascisme qui gangrène notre société », ceux-ci restaient non seulement insensibles à sa lutte mais considéraient ses propos comme autant de réflexions d’adolescent attardé. Il m’a expliqué qu’il avait été enseignant pendant quelque temps – il a fait de brillantes études universitaires et a passé deux masters – mais qu’il ne supportait plus les professeurs qui ne voient pas ce qui se passe autour d’eux et qui sont d’une passivité coupable. Il a tenté d’alarmer les personnes qu’il rencontrait auparavant aux terrasses des cafés de gauche qu’il fréquentait mais « personne n’a le courage de réagir et ils ne m’écoutent même plus ! » Se retirant alors dans son appartement, il a publié ses réflexions et analyses antifascistes sur Facebook, mais il a d’abord perdu tous ses « amis » : « Je les ai tous “tués” l’un après l’autre, en les supprimant comme amis. Ensuite j’ai continué à utiliser mon “mur” pour alerter les gens. Mais j’ai aussi été censuré par Facebook et interdit d’utilisation pendant une période… Je me suis retrouvé tout seul, complètement désocialisé. Ma mère a menacé de me faire interner, alors j’ai décidé de lui montrer ce que c’est que d’être enfermé et je l’ai séquestrée dans sa chambre. Je lui avais confisqué son portable, mais j’avais oublié son ordinateur ! Du coup, quand je suis rentré à la maison après l’avoir fait patienter pendant quelques heures, j’ai été accueilli par des policiers et conduit à l’hôpital psychiatrique. »
Face à ce constat lamentable, je lui fais alors remarquer que, malgré son intelligence, avérée par ses résultats universitaires, et malgré la légitimité de son combat, la stratégie qu’il utilise pour le mener est complètement inefficace : « Excusez ma franchise mais au vu des conséquences que votre combat entraîne, je dois vous dire qu’au point de vue stratégique, vous êtes complètement nul ! » Le visage du patient s’illumine alors et il acquiesce en me tapant dans la main: « Bien vu, bon alors qu’est-ce que je dois faire ? »
Nul besoin de lui demander de se calmer, de l’amener à prendre conscience de ses excès, d’essayer de le « raisonner »… il est prêt à se tourner vers l’avenir. Je l’invite notamment à sortir dans certains endroits où il avait des connaissances, à écouter attentivement les gens qu’il y rencontrera afin de pouvoir faire un tri entre les personnes accessibles à son discours et les autres (ce qui l’oblige à être moins interprétatif) et de pouvoir construire des stratégies plus « subtiles » pour les convaincre. La « réalité » du patient n’a pas été remise en question : en l’acceptant je ne soulève pas de résistances sur le contenu mais je prépare le patient à revoir sa « stratégie », donc à changer de comportement pour atteindre son objectif.
Le questionnement ou dialogue stratégique est un processus qui conduit le patient à changer sa perception grâce aux découvertes qu’il fait à travers les échanges.
Converser dans un climat d’ouverture et de tolérance
Ce que j’aime toujours autant qu’à mes débuts de thérapeute, c’est la première rencontre avec le patient, cette espèce d’étonnante expérience anthropologique, la découverte d’un autre rapport à la vie, d’un autre monde, à chaque fois foncièrement semblable, à chaque fois merveilleusement singulier. Je suis curieux et j’aime découvrir la façon dont les patients racontent leur histoire, les croyances auxquelles ils s’accrochent, les obstacles qu’ils redoutent, les drames qui les ont marqués parfois, mais aussi les petites manies, les faiblesses, les jalousies mesquines, les combats perdus d’avance, les remords, les regrets, … bref toutes ces failles de l’individu qui révèlent notre appartenance commune à la condition humaine.
J’essaie d’induire un climat dans lequel on peut aborder les sujets les plus délicats sans honte : oser nommer les choses, oser franchir les limites de la pudeur qui enferme, qui isole. Oser exprimer ses faiblesses, ses failles, ses petits travers, ses secrets honteux, ses craintes infantiles, ses pensées les plus inavouables, ses intentions effrayantes… Pour se rendre compte que l’on peut en rire aussi lorsqu’elles sont affrontées, qu’elles ne sont que virtuelles, irrationnelles, nourries par notre imagination et que le simple fait de les exprimer les fait disparaître comme les fantômes au réveil.
Depuis que je fais de la thérapie, j’ai toujours filmé mes séances, et cette formule me convient très bien et ne dérange pas la plupart de mes patients. Parfois, des stagiaires observent les séances en direct et cela entraine un surcroît de tension, d’attention soutenue, de rigueur nécessaire aussi, mais cela en douceur, sans autocontrôle paralysant. Cet affrontement et cette exposition immédiate ont sans doute permis de construire une bonne dose de confiance en mes capacités (et mes limites !) de thérapeute et aussi de sécurité personnelle. Je n’ai pas la crainte d’être mis en difficulté, j’éprouve du plaisir à découvrir chaque nouveau patient et son monde singulier. Quand on s’expose au regard de ses pairs, on est forcé de lâcher prise en séance ; on sait que l’on fera des erreurs, des bévues, des fautes de langage, de grammaire, de syntaxe. On ne pourra s’empêcher de bafouiller de temps en temps, de répéter les mêmes choses, d’oublier des informations… On le sait et on fait avec parce que le plus important, c’est la façon dont se déroule l’interaction, ce qui passe entre le patient et le thérapeute, l’émotion produite, l’influence réciproque, bref tout ce qui se passe de façon analogique durant la séance.
J’aime mettre mes patients à l’aise, faire en sorte qu’ils oublient le contexte un peu artificiel du cabinet. Il m’arrive souvent d’évoquer des histoires personnelles, des anecdotes pour faire écho aux leurs. J’aime montrer que la vie est une suite de difficultés pour nous tous, que l’on peut même en rire ensemble. Cela incite le patient à parler simplement, à oser évoquer ses faiblesses, ses erreurs… J’aime que le dialogue soit naturel, direct, et que le patient et moi-même soyons tous les deux impliqués dans la recherche active d’une solution à ses difficultés.
Je considère comme une grande chance de pouvoir échanger avec mes congénères à propos de la vie, des choses à la fois importantes et pourtant si banales, pour lesquelles chacun doit trouver son propre chemin. Durant tout le travail thérapeutique, ils partagent avec moi une rare intimité et me révèlent les couleurs singulières avec lesquelles ils composent leur vie. Ils me confient des exemples uniques et précieux de l’infinie diversité des formes que prend la vie et comment nous incarnons chacun notre humanité commune. C’est une belle manière de me payer en retour pour l’aide que j’essaie de leur apporter.
Ecce homo.
JJW
Intéressé par la thérapie systémique et stratégique ? Ceci est pour vous :
La force principale du modèle de Palo Alto, c’est qu’il propose une méthode, une méthode de résolution de problèmes personnels et relationnels, une méthode identique quel que soit le contexte dans lequel ce problème se manifeste. Cette méthode permet de comprendre la façon dont les problèmes « fonctionnent », d’en saisir la « logique », et, du coup, de pouvoir élaborer une stratégie de changement efficace et réaliste et de créer un contexte relationnel de confiance qui incite le patient (ou le client) à suivre les prescriptions suggérées par l’intervenant.
C’est cela qui attire tous les participants qui ont déjà suivi des formations telles que PNL, hypnose éricksonienne, pleine conscience, thérapies orientées solutions, sophrologie, etc. Ils ont le sentiment de pouvoir situer leurs acquis dans un cadre global cohérent.
Alors, si vous souhaitez être initié de façon rigoureuse et étayée à l’approche systémique et stratégique par un praticien confirmé, et selon le domaine qui est le vôtre, nous vous proposons :
Initiation à la thérapie systémique et stratégique (2 ou 3 journées animées par J.-J. Wittezaele)
[ Menu ]
2. Anarchy in the ΨK
« DE LA FOLIE MAIS QUI NE MANQUE PAS DE MÉTHODE » (Shakespeare, Hamlet, II, 1.)
Recherche : The « Psychotic Factor »
Depuis assez longtemps, je suis intéressé par ce qui fait la nature de la différence entre les patients « habituels » et les « psychotiques ».
Je ne sais pas si cette différence — d’ailleurs souvent ressentie (comme on parle d’une température ressentie en météo !) plutôt qu’avérée selon des critères précis — est de nature physique (un problème dans les neurones ou les neurotransmetteurs, par exemple) ou si elle est (aussi?) de nature psychologique. Dans cette dernière hypothèse, on ne comprend pas exactement l’interaction entre la personne et son contexte qui pourrait entraîner pareil « effondrement » ou « perte des repères habituels » qui permettent une vie sociale correcte.
Après un survol des positions des chercheurs, je trouve que rien n’est vraiment convaincant en termes de relation causale d’ordre biochimique. On évoque beaucoup de corrélations mais, de mon point de vue, celles-ci permettent surtout aux chercheurs de justifier leurs hypothèses. Bref, je pense que dans ce domaine extrêmement sensible (étant donné l’impact social des symptômes de certains patients, notamment les comportements très paranoïaques, les voix, les hallucinations ou encore les crises de violence…) la réaction actuelle est surtout sécuritaire et que, en tout cas pour les psychiatres traditionnels disons, la réponse est avant tout d’essayer de trouver des combinaisons de molécules qui peuvent arrêter ou faire baisser l’intensité émotionnelle et les symptômes les plus spectaculaires ou potentiellement dangereux. Et je comprends bien cette réaction car, effectivement, il s’agit aussi de protéger les patients et leur entourage.
Ceci dit, il arrive aussi fréquemment que les symptômes diminuent en intensité mais que la « structure » (ce n’est peut-être pas le terme le plus approprié) de pensée et de comportements reste pratiquement intacte. J’ai moi-même rencontré pas mal de patients sous médication nier d’abord leurs symptômes mais retombant dans les mêmes schémas dès qu’ils se sentent en sécurité et qu’ils ne redoutent pas une augmentation des doses de médicaments.
Grâce à la thérapie systémique et stratégique (là encore, d’autres approches sont sans doute possibles), nous disposons d’outils thérapeutiques efficaces pour traiter certains symptômes qui sont « spectaculaires », comme le fait d’être le jouet de « voix », de partir dans un emballement d’interprétations paranoïaques, de lutter contre les phases dépressives, etc. Et finalement que reste-t-il de la « psychose » si ces conduites-là ne perturbent plus le patient ?
Je suis pour ma part convaincu qu’il est possible d’atteindre des résultats cliniques probants à partir d’une approche systémique et stratégique, d’une part, et surtout d’éviter une « chronicisation » de l’état des patients ou alors une sorte de renoncement ; dans de tels cas, les patients finissent pas s’adapter à une rythme de vie débarrassé des contraintes de la vie sociale (les malades mal élevés comme les appelait Jay Haley) et retirent une sorte de bénéfices secondaires dont ils se contentent finalement. Je pense que le fait d’être soignés principalement par des médicaments les rend passifs et donc de moins en moins enclins à se lancer dans un travail psychothérapeutique.
Je ne sais pas ce qu’il en est dans les diverses institutions psychiatriques de France, de Belgique et de Suisse, mais, en tout cas, dans certains hôpitaux psychiatriques parisiens, le premier réflexe (et unique après 2 mois) des médecins lors de l’admission d’un patient présentant des symptômes potentiellement « psychotiques » (délires, hallucinations, conduites asociales, etc.), c’est de trouver la médication qui va calmer les symptômes. Je pense malheureusement que cela ne facilite pas la prise en charge future et colore immédiatement la relation complémentaire entre patient et psychiatre. En effet, n’étant pas du tout concerné par le traitement (c’est le psychiatre qui sait !), le patient réagit immédiatement par de l’opposition contre le mode de traitement et, du coup, fait passer son problème à l’arrière-plan. Pour moi, le patient se bat alors contre la psychiatrie plutôt que pour sa santé et la résolution de ses problèmes. Problèmes qui sont bien réels d’ailleurs. Bien que je ne partage pas la vision biochimique de l’approche médicale, je ne suis pas du tout pour une approche antipsychiatrique. Il y a encore beaucoup de choses à dire et à faire après la théorie de la double contrainte. Pour ma part, si Bateson a pu cerner des doubles contraintes systémiques, je pense qu’on n’a pas assez formalisé les paradoxes individuels dans lesquels peuvent se mettre eux-mêmes certains patients. Et surtout, on n’a pas assez travaillé les aspects individuels de ce type de troubles avec une vision systémique et stratégique, c’est-à-dire responsabilisante, pragmatique et constructiviste, en partant de la réalité du patient, même psychotique.
3. Vers une psychiatrie plus écologique…?
Voici un texte que j’ai rédigé pour la revue française Santé Mentale qui en a publié une bonne partie dans son numéro 211 d’octobre 2016.
La relation thérapeutique en psychiatrie et le dialogue stratégique
1. Regard d’un psychologue sur la négociation des soins en psychiatrie
Lorsqu’on m’a contacté pour contribuer à ce dossier, le terme « négociation » m’a surpris, et j’ai pensé: « Mon Dieu, les psychiatres doivent être bien démunis s’ils se montrent prêts à lâcher une partie du contrôle sur la prise en charge des patients ». Au premier abord, en effet, on ne voit pas ce qui pourrait être négocié dans un traitement médical. Par contre, on sait qu’il arrive assez fréquemment que des patients s’opposent à la prise de médicaments et que la relation psychiatre/patient peut se dégrader jusqu’à mettre le traitement en péril. Les médecins sont ainsi forcés de reconnaître que les patients ont aussi le pouvoir de les mettre en échec et cela peut les conduire à chercher à établir avec eux une relation plus constructive.
Mais cette tendance au partage des responsabilités est également dans l’air du temps. En effet, dans notre culture, des associations défendent les droits des malades mentaux à être traités de façon plus humaine, moins stigmatisante et plus « responsable » ; certains patients présentant des conduites idiosyncrasiques revendiquent le respect de leurs différences, on voit apparaître des associations d’entendeurs de voix ou d’« anciens schizophrènes » qui réclament une prise en considération de leur réalité et des traitements moins agressifs. On avait déjà du mal à faire en sorte que les patients prennent leurs médicaments et voici qu’en plus il faut tenir compte de leurs desiderata !
Ces revendications sont parfois incompatibles avec les attentes sécuritaires de la population et des pouvoirs publics qui ont investi les psychiatres de la mission de protéger leurs concitoyens des conduites dangereuses de leurs patients. La psychiatrie serait-elle dans une sorte de double contrainte : devoir imposer un traitement efficace avec l’accord des patients (une variante du paradoxe : « sois spontané ») ?
La position des psychothérapeutes est très différente à cet égard, et il leur est sans doute plus simple de négocier la participation de leurs patients dans le processus thérapeutique, voire de les responsabiliser. Avant d’exposer la façon dont nous envisageons cette question à partir d’une vision systémique et stratégique et d’exposer ce que nous appelons le dialogue stratégique, je vais signaler – de mon point de vue de psychologue - certaines des difficultés rencontrées par l’approche médicale, notamment celles qui sont engendrées par la fonction sécuritaire et celles qui sont inhérentes à la méthode utilisée. Cela me permettra de suggérer quelques pistes pour établir un contexte relationnel favorisant l’adhésion des patients au traitement proposé.
Les difficultés liées à la fonction sécuritaire de la psychiatrie
La psychiatrie ne doit pas seulement viser à soulager le patient ; on attend aussi qu’elle veille à ce qu’il ne constitue pas un danger pour les autres citoyens. Cela engendre inévitablement une pression à la neutralisation des conduites potentiellement dangereuses pour autrui (et pour le malade lui-même) au détriment parfois d’une approche globale de la problématique et de la personne.
La fonction sécuritaire que les psychiatres ont accepté d’exercer dans notre société leur offre des avantages certains en leur procurant un rôle important aux yeux du grand public : qui peut, sans l’aide des médicaments, ramener le calme chez les agités, empêcher les passages à l’acte sur soi-même ou sur autrui, faire cesser les crises de violence ou les crises d’angoisse extrême ? En étant les uniques prescripteurs de psychotropes, les médecins s’assurent donc du soutien des médias et des pouvoirs publics soucieux de maintenir l’ordre, ainsi que de l’appui indéfectible des puissantes firmes pharmaceutiques.
Mais, la question se pose différemment quand il s’agit non pas de calmer mais de soigner et de guérir. Le psychiatre se retrouve vite dans une posture répressive peu compatible avec son rôle de médecin. Un de mes patients d’une quarantaine d’années qui a fait des épisodes délirants est aujourd’hui sous tutelle et doit aller consulter un psychiatre régulièrement. Il y a un an et demi, il a « fugué » dans une ville de province pendant 6 mois. Pendant cette période, il n’a pris aucun médicament et s’est débrouillé en faisant des petits boulots pour gagner sa vie, et ce sans problème. Un jour, lors d’un contrôle dans le restaurant où il faisait la plonge, on découvre qu’il est soumis à une mesure de contrainte. Renvoyé chez ses parents, le psychiatre l’oblige à prendre des neuroleptiques retard : une injection toutes les trois semaines. Durant les deux premières semaines, il souffre de diarrhées, d’une perte totale de libido, d’une incapacité à se concentrer, etc. Cela ne lui donne pas l’envie de poursuivre son traitement, on peut comprendre pourquoi : il le prend avant tout comme une punition pour avoir désobéi. Il se trouve aussi pris dans un paradoxe : s’il dit qu’il va mieux, on lui explique que c’est grâce au médicaments, donc il doit surtout continuer à les prendre ; s’il ne va pas mieux, on change de médication ou on augmente les doses.
En assumant le rôle de gardien de l’ordre public, le psychiatre doit maintenir une position d’autorité peu compatible avec la négociation. Pourtant s’il veut responsabiliser ses patients et les amener vers plus d’autonomie, il lui est parfois nécessaire de prendre certains risques (plus ou moins calculables) pour que le patient puisse reprendre confiance en ses propres ressources. Cela peut alors jeter les bases d’une réelle négociation des soins avec le patient et sa famille. Sinon, on peut craindre que le psychiatre, en essayant de se montrer à la hauteur des attentes sociales (excessives (14)) qu’il a suscitées, finisse par perdre son âme de médecin et devenir, de plus en plus, un agent de contrôle social. De mon point de vue, plutôt que de promettre ce que l’on n’est pas sûr de pouvoir tenir, il serait sans doute plus prudent de reconnaître les limites des soins existants, et laisser aux magistrats et aux représentants de l’ordre public le soin de prendre les mesures de sécurité nécessaires.
Les difficultés liées à l’approche médicale des troubles mentaux
Pour la grande majorité des psychiatres, les troubles mentaux sont liés à un dysfonctionnement du cerveau, plus spécifiquement à un déséquilibre biochimique des neurotransmetteurs. Ce positionnement situe directement la relation psychiatre/patient comme une relation complémentaire dans laquelle le premier est censé être en position haute (il détient le savoir) et l’autre en position basse (il s’en remet au médecin pour aller mieux). Dans la plupart des spécialisations médicales, on trouverait bizarre qu’un patient remette son traitement en question ou doive être convaincu du bien-fondé d’un examen ou d’analyses alors que le praticien a pris la peine de lui expliquer les raisons de son ordonnance. C’est le patient qui souhaite être soulagé de sa souffrance et il importe que le médecin veille à ce que les rôles ne s’inversent pas, le médecin finissant par vouloir le changement plus que le patient ! Si un patient refuse un traitement, le médecin peut le traiter comme une personne responsable et l’adresser à un confrère ou lui faire signer une décharge.
Qu’en est-il de la relation entre psychiatre et patient souffrant de troubles mentaux ? On est loin de la même soumission consentie, c’est une évidence. Il arrive fréquemment que la relation se dégrade, que le patient remette partiellement voire totalement en question le traitement ou, en tout cas, s’oppose ou arrête de suivre son traitement médicamenteux. Nous allons passer en revue différentes étapes du traitement et voir ce qui pourrait être fait pour favoriser l’émergence d’une relation de confiance.
L’accueil. Les résistances du patient sont parfois simplement liées à la façon dont il est accueilli à l’hôpital. Un patient qui arrive ou est amené à l’hôpital est souvent aux prises avec une réalité infestée de fantômes, d’angoisse, de pensées obsédantes et/ou morbides, de sensations effrayantes, etc. Même si on considère que cela est dû uniquement à un dysfonctionnement neurologique, on ne peut nier la perception que le patient a de lui-même et du monde qui l’entoure. Si le médecin n’en tient pas compte, il aura du mal à établir une relation thérapeutique fructueuse, le patient ne se sentant pas considéré comme une personne. S’il n’est pas toujours possible d’établir un dialogue avec le patient lorsqu’il est en crise, le médecin peut profiter des premiers signes d’amélioration pour établir un contact personnalisé, informant le patient sur son trouble et envisageant avec lui la façon dont il envisage le traitement. Encore une fois, il ne s’agit pas de s’engager au-delà de ce que le psychiatre peut promettre mais de permettre au patient de comprendre ce qui l’attend et ce que le médecin attend de lui.
Les relations avec les familles ou les proches. Lorsque le patient n’est pas complètement isolé, son problème a des implications importantes pour ses proches : conjoint, parents, amis … Ceux-ci sont directement touchés par ce qui arrive au patient et sont souvent perdus quant à l’aide qu’ils peuvent lui apporter ou même quant à la façon de se conduire face à lui et à gérer des comportements incompréhensibles ou effrayants. Ils se posent souvent de nombreuses questions : de quoi souffre-t-il ? Quel est le pronostic ? Quelle sera la durée du traitement? Que pouvons-nous faire pour aider (ou pour le/nous protéger) ? Leurs tentatives sont souvent maladroites, voire contre-productives, et il est important de prendre du temps pour les informer et éventuellement leur suggérer des façons plus constructives de gérer les conduites du patient. Dans la mesure où le psychiatre peut les éclairer sur la conduite à tenir et sur l’évolution probable du problème, la famille, considérée comme partie prenante des soins, se montrera plus encline à collaborer.
Le type de questionnement et le diagnostic. Le mode d’entretien préconisé par la thérapie stratégique est très différent de celui pratiqué par les thérapeutes qui basent leurs interventions sur les catégories du DSM. Ce dernier incite en effet le clinicien à rechercher les signes cliniques susceptibles de déterminer le type de pathologie dont souffre son patient afin de pouvoir lui appliquer le traitement correspondant. C’est la nécessité de situer le patient dans une catégorie définie qui constitue l’objectif du questionnement, et détermine donc l’orientation de l’entretien. Cette approche soulève toutefois énormément de résistance et les patients ainsi examinés et interrogés peuvent se sentir réduits à une « collection de symptômes » et se défendre en refusant ce type d’observation et de questionnement. Nous monterons plus loin comment le dialogue stratégique permet de contourner cet écueil.
Les échanges avec le patient. Durant les entretiens avec le psychiatre, il est habituel que les patients posent des questions pour comprendre ce qui leur arrive ou ce qui les attend. Certaines questions sont légitimes, d’autres indiquent que le patient n’accepte pas la relation complémentaire avec le psychiatre. Il existe de nombreuses techniques de communication qui permettent de contourner les résistances du patient et d’augmenter sa motivation à participer au traitement. Pourtant, on peut constater que, la plupart du temps, les moyens que nous utilisons pour encourager le patient sont en fait des tentatives de bon sens dont l’inefficacité est notoire : vouloir convaincre son patient à tout prix, l’exhorter, le menacer, lui faire avouer qu’il a un problème, que sa réalité n’est pas la « vraie »…
La nature de la maladie et du traitement proposé. Le traitement est du ressort du psychiatre, on ne voit pas comment un patient pourrait avoir son mot à dire sur les médicaments qu’il est censé prendre. Néanmoins, si sa réalité psychologique n’est pas prise en compte, le patient peut réagir en s’opposant au traitement chimique. Le problème se déplace et le patient se bat alors contre la psychiatrie plutôt que pour sa santé et la résolution de ses problèmes. Problèmes qui sont bien réels d’ailleurs et qui, du coup, passent à l’arrière-plan, obscurcis par l’escalade symétrique.
De mon point de vue, l’option « tout biochimique » n’est pas tenable aujourd’hui. Si, grâce au DSM, les diagnostics peuvent être extrêmement fins et différenciés, il faut reconnaître que les traitements médicamenteux restent encore souvent sommaires et approximatifs. Même si la pharmacologie évolue, il arrive que les patients réalisent que la médication entraine des conséquences (effets secondaires) qui les empêchent de vivre une vie qui vaut la peine. Personnellement, je suis amené à suivre des patients qui, malgré les médicaments, manifestent toujours leurs symptômes : des schizophrènes qui continuent à délirer, des paranoïaques qui partent en vrille, des dépressifs qui dépriment, des « toqués » qui continuent de recourir à leurs rituels… Avec moins d’anxiété, c’est sûr, et c’est un réel soulagement, mais au vu de la façon dont tourne le monde, on se demande comment des neurotransmetteurs en bon état de fonctionnement pourraient garantir une vie psychologique sans souci majeur ?
Contrairement à une opinion largement répandue dans notre culture, nous pensons que pour qu’une confiance puisse s’instaurer entre le praticien et son patient, il est bon de ne pas taire ou atténuer certains risques liés à la médication. Dans ce cas, la règle doit être « afficher plutôt que cacher ». Si le patient découvre des effets indésirables non anticipés, il risque d’en rendre le médecin responsable et donc de se méfier de lui à l’avenir.
Un échange pourrait sans doute s’instaurer entre les deux parties à propos des aménagements possibles : certaines molécules plutôt que d’autres, une injection retard ou non, les conséquences d’un oubli ou d’un refus, l’intervention (ou non) d’un parent ou du conjoint dans la gestion de la médication, etc.
2. L’approche systémique et stratégique (15)
Nous proposons donc une alternative communicationnelle à l’approche médicale et au traitement médicamenteux de ces troubles. Cette alternative repose sur une approche interactionnelle du comportement humain : l’être humain vivant est en interaction constante avec son milieu et, pour comprendre son comportement, il faut savoir comment il interagit. Les informations qu’il reçoit à travers ces interactions sont véhiculées par nos neurones et font émerger, grâce au fonctionnement de notre cerveau et de l’ensemble de notre organisme, le monde virtuel et dynamique de notre vie psychologique. Nous pourrions dire que la réalité psychique est au fonctionnement de notre cerveau ce que l’informatique est au fonctionnement des ordinateurs.
L’être humain doit s’organiser pour survivre dans un environnement sans cesse changeant : il doit pouvoir s’adapter à des changements internes et externes de façon à préserver son intégrité et satisfaire ses besoins. Il doit pouvoir détecter les menaces et les dangers et s’en protéger, dépasser ou contourner les obstacles à la réalisation de ses désirs.
Nous pensons que la clé des troubles mentaux ne se trouve ni dans la biologie du cerveau ni dans le contexte psychosocial, mais dans l’interface entre les deux, à savoir le système de perception/réaction des individus : pour nous, ce sont les informations que les personnes perçoivent et la façon dont elles y réagissent qui constituent la matrice de ce que l’on appelle la « santé mentale ».
Si nous ne basons pas nos explications des troubles sur les causes passées, nous proposons néanmoins une étiologie cybernétique de leur formation et de leur fonctionnement : ce sont les réactions des patients, leurs tentatives de solution, qui transforment une situation difficile à gérer en problème récurrent. Ces tentatives ne produisent pas le résultat escompté, c’est-à-dire qu’elles ne permettent pas de résoudre le problème donc à faire en sorte que l’individu retrouve un état global satisfaisant. Au contraire, elles ne font que l’amplifier provoquant ainsi un emballement de l’interaction : plus le patient y recourt, plus la difficulté est alimentée et s’accroît. Cet emballement de l’interaction va alors entrainer toute une série de conséquences systémiques jusqu’à former des équilibres stables mais dysfonctionnels (les « troubles mentaux ») qui présentent une cohérence interne que l’on peut faire émerger par le dialogue stratégique.
Le dialogue stratégique
La façon dont nous menons nos entretiens reflète nos prémisses. Nous partons de la perception de la situation problématique (anxiogène, par exemple) par le patient lui-même, la reconnaissant pour vraie (pour ce qui le concerne), puis la faisant évoluer vers une solution grâce à des prescriptions, des tâches diverses censées corriger le dysfonctionnement. Nous ne cherchons donc pas à identifier des symptômes, puis à voir à quelle catégorie psychopathologique ceux-ci correspondent, pour, ensuite, annoncer (ou pas!) au patient la « nature » de son trouble, c’est-à-dire lui faire reconnaître et accepter qu’il souffre de telle ou telle maladie. Nous recherchons les processus interactionnels élémentaires qui dysfonctionnent et qui génèrent les symptômes, c’est-à-dire ce que nous appelons les « tentatives de solution ».
Le potentiel de la situation. Le thérapeute bâtit sa stratégie en s’appuyant sur les ressources qu’une situation problématique recèle, le « potentiel » qu’il pourra utiliser et faire évoluer pour conduire son patient vers la résolution du problème. Pour saisir ce potentiel, il évalue les ressources relationnelles disponibles et parmi elles le meilleur levier de changement (famille, bien sûr, mais aussi parfois des proches qui se préoccupent ou avec qui le patient a une relation forte et signifiante), repère les éléments du contexte que le patient n’arrive pas à réguler de façon satisfaisante ainsi que la logique dysfonctionnelle qui contrôle ses réactions, et identifie également l’objectif poursuivi par le patient ainsi que l’histoire qu’il s’est construite et qui apporte une cohérence au fonctionnement du problème. Cela bien sûr donne une place importante au contexte de vie du patient et signifie que le thérapeute prend en considération la réalité du patient.
C’est en s’appuyant sur ces éléments de départ, donc en étant attentif et en acceptant la vision du problème développée par le patient, qu’il pourra établir la relation de confiance nécessaire au bon déroulement du processus thérapeutique, et donc déplacer l’attention du contenu au processus.
La question des soins se pose différemment que l’on présume que le problème est biochimique ou que l’on envisage le problème comme une difficulté pour le patient de réagir de façon appropriée face à certains contextes de sa vie. Même un patient vindicatif peut s’apaiser assez vite et reconnaître qu’il a besoin d’aide, comme le montre l’exemple suivant. Nous avons reçu un patient venu consulter parce que, disait-il, « sinon il ne me reste plus que le suicide ». La quarantaine, il se retrouvait complètement isolé socialement et s’était résolu à retourner vivre chez ses parents avec lesquels il était en conflit permanent. Il avait beau leur expliquer qu’il est nécessaire de mener un combat contre « le fascisme qui gangrène notre société », ceux-ci restaient non seulement insensibles à sa lutte mais considéraient ses propos comme autant de réflexions d’adolescent attardé. Il nous a expliqué qu’il a été enseignant pendant quelque temps – il a fait de brillantes études universitaires et a passé deux masters – mais qu’il ne supporte plus les professeurs qui ne voient pas ce qui se passe autour d’eux et qui sont d’une passivité coupable. Il a tenté d’alarmer les personnes qu’il rencontrait auparavant aux terrasses des cafés de gauche qu’il fréquentait mais « personne n’a le courage de réagir et ils ne m’écoutent même plus ! » Se retirant alors dans son appartement, il a publié ses réflexions et analyses antifascistes sur Facebook, mais il a d’abord perdu tous ses « amis » : « Je les ai tous “tués” l’un après l’autre, en les supprimant comme amis. Ensuite j’ai continué à utiliser mon “mur” pour alerter les gens. Mais j’ai aussi été censuré par Facebook et interdit d’utilisation pendant une période… Je me suis retrouvé tout seul, complètement désocialisé. Ma mère a menacé de me faire interner, alors j’ai décidé de lui montrer ce que c’est que d’être enfermé et je l’ai séquestrée dans sa chambre. Je lui avais confisqué son portable, mais j’avais oublié son ordinateur ! Du coup, quand je suis rentré à la maison après l’avoir fait patienter pendant quelques heures, j’ai été accueilli par des policiers et conduit à l’hôpital psychiatrique. »
Face à ce constat lamentable, le thérapeute lui fait alors remarquer que, malgré son intelligence, avérée par ses résultats universitaires, et malgré la légitimité de son combat, la stratégie qu’il utilise pour le mener est complètement inefficace : « Excusez ma franchise mais au vu des conséquences que votre combat entraîne, je dois vous dire que vous vous y prenez vraiment très très mal pour atteindre votre objectif ! » Le visage du patient s’illumine alors et il acquiesce en tapant dans la main du thérapeute : « Bien vu, bon alors qu’est-ce que je dois faire ? » Nul besoin de lui demander de se calmer, de l’amener à prendre conscience de ses excès, d’essayer de le « raisonner »… il est prêt à se tourner vers l’avenir. Et le travail est enclenché pour déterminer avec lui comment il pourrait s’y prendre avec plus de chances de succès (ce qui est porteur pour lui), ce qui donnera l’occasion au thérapeute de bloquer ses tentatives de solution (la validation d’une croyance selon laquelle personne ne veut écouter ses cris d’alarme et l’évitement généralisé qui en découle). Le thérapeute l’invite notamment à sortir dans certains endroits où il avait des connaissances, à écouter attentivement les gens qu’il y rencontrera afin de pouvoir faire un tri entre les personnes accessibles à son discours et les autres (ce qui l’oblige à être moins interprétatif) et de pouvoir construire des stratégies plus « subtiles » pour les convaincre. La « réalité « du patient n’a pas été remise en question, en l’acceptant le thérapeute ne soulève pas de résistances sur le contenu mais il prépare le patient à revoir sa « stratégie », donc à changer de comportement pour atteindre son objectif.
Le questionnement ou dialogue stratégique est un processus qui conduit le patient à changer sa perception grâce aux découvertes qu’il fait à travers cet échange.

Un langage évocateur. Pour induire le changement, il est important d’amener la personne à ressentir différemment plutôt qu’à penser différemment. C’est pourquoi il vaut mieux utiliser un langage évocateur (métaphores, aphorismes, anecdotes, histoires…) pour éveiller des sensations appropriées au but thérapeutique, donc stimuler l’envie de changer car, comme l’avait remarqué Pascal : « Pour convaincre l’esprit, il est nécessaire de toucher et de prédisposer le cœur. »
Cette façon différente d’envisager le traitement peut incommoder les spécialistes du diagnostic différentiel, nous en sommes conscients, mais nous pensons que le dispositif que nous proposons s’avère efficient et moins stigmatisant, permet aussi de limiter les résistances aux prescriptions et facilite l’établissement d’une bonne relation thérapeutique.
L’alternative que nous proposons ne permet pas de remplir certaines fonctions remplies par le DSM aujourd’hui, notamment de situer les patients dans des catégories reconnues par les systèmes de santé et qui donnent droit à des traitements particuliers comme des arrêts maladie ou des prises en charge hospitalières remboursées par la sécurité sociale ou les mutuelles. Nous pensons qu’un jour ou l’autre cependant cette classification en fonction des « pathologies » sera jugée discriminatoire et nous renverra à notre positionnement face à l’altérité du « malade mental ».
On le voit, le dialogue stratégique permet d’éviter bien des résistances en s’appuyant sur la réalité du patient. Le thérapeute stratégique n’est pas prêt pour autant à négocier le cadre de l’intervention. Accepter les droits des patients n’implique pas que le thérapeute doive renoncer à la relation complémentaire qui lui permet d’utiliser ses compétences pour sortir le patient des impasses dans lesquelles le conduit sa perception dysfonctionnelle de la réalité.
Peut-on rêver d’un dialogue stratégique entre les deux approches ?
Vous travaillez en psychiatrie ou vous recevez des patients présentant des troubles complexes (étiquetés ou non : TOC, troubles anxieux divers, paranoïa, schizophrénie…) et vous souhaitez apprendre à pratiquer l’entretien systémique et stratégique ? Alors ceci est pour vous :
Formation de 3 journées organisée par Écologie de l’esprit et animée par Jean-Jacques Wittezaele :
L’entretien systémique et stratégique en psychiatrie - Les fondements, la méthode, la pratique –
[ Menu ]
L’approche systémique et stratégique appliquée au travail social
Cela fait plus de 30 ans maintenant, que nous avons introduit cette méthode de travail dans le secteur de la Protection de la jeunesse en Belgique, et également dans les Maisons de Justice où l’approche est devenue la référence méthodologique officielle et explicite.
Le choix de cette approche repose sur ses caractéristiques : vision systémique, donc globale, dynamique et évolutive de la personne ; approche non normative (respect de la réalité de chacun) ; utilisation de toutes les ressources personnelles et relationnelles ; vision constructive des capacités de changement de l’individu (l’individu est en devenir).
Il s’agit d’une approche stratégique dans laquelle toutes les interventions visent à atteindre les objectifs concrets définis, à savoir en priorité l’arrêt de la mesure de contrainte et l’insertion sociale.
Il se trouve que j’ai élaboré un petit manuel pratique à destination des personnes travaillant avec les enfants, les adolescents et leurs familles en difficultés.
Guide pratique d’application de l’approche systémique et stratégique dans les secteurs de la Protection de la jeunesse, de l’Aide à l’enfance et de Protection judiciaire
Ce texte est destiné aux personnes qui travaillent dans le secteur de la Protection de la jeunesse, de l’Aide à l’enfance, en foyers ou en milieu ouvert. Il vise à mieux préparer au décodage des situations et à l’application des techniques d’intervention issues de l’Ecole de Palo Alto dans le contexte du travail sur mandat d’une autorité avec des jeunes en difficultés, et en vue de leur insertion sociale.
Le secteur de la Protection de la jeunesse, en Belgique, a été intéressé par notre approche pragmatique, focalisée sur la recherche de solutions concrètes pour les jeunes qui faisaient l’objet de mesures de protection sociale et/ou judiciaire. Une méthode responsabilisante, non substitutive, non normative, visant l’autonomisation des jeunes ou de leurs familles limitant les dommages potentiels (stigmatisation) d’interventions trop longues et invasives. Il se trouve que ces principes guident notre travail.
Notre souci a toujours été de veiller à établir des relations respectueuses des différences. Nous avons donc choisi de présenter :
- D’abord la façon dont chacun construit sa réalité en fonction des contraintes que le milieu impose, et comment chacune de ces constructions du monde est unique et respectable.
- Une vision globale du contexte d’intervention des services sociaux ou judiciaires, l’Etat de Droit.
- L’évolution de nos pratiques d’intervention avec l’introduction de l’approche de Palo Alto.
- La mise en évidence du « paradoxe de l’aide contrainte »…
- … et la solution que nous y avons apportée : la réunion tripartite.
- Un modèle pour faciliter les procédures d’admission d’un jeune
- Et enfin les caractéristiques de l’entretien stratégique, outil de travail essentiel dans l’accompagnement des jeunes et de leurs familles.
Vous voulez obtenir une copie du texte intégral (26 pages) ? Faites-en la demande à l’adresse suivante : jean-jacques.wittezaele@ecologie-esprit.com
Vous travaillez dans le social et vous souhaitez à apprendre à utiliser l’entretien systémique et stratégique dans votre pratique ? Des formations spécifiques, animées par des personnes de terrain spécialisées dans l’approche systémique et stratégique, sont organisées.
La force principale du modèle de Palo Alto, c’est qu’il propose une méthode, une méthode de résolution de problèmes personnels et relationnels, une méthode identique quel que soit le contexte dans lequel ce problème se manifeste. Cette méthode permet de comprendre la façon dont les problèmes « fonctionnent », d’en saisir la « logique », et, du coup, de pouvoir élaborer une stratégie de changement efficace et réaliste et de créer un contexte relationnel de confiance qui incite le patient (ou le client) à suivre les prescriptions suggérées par l’intervenant.
C’est cela qui attire tous les participants qui ont déjà suivi des formations telles que PNL, hypnose éricksonienne, pleine conscience, thérapies orientées solutions, sophrologie, etc. Ils ont le sentiment de pouvoir situer leurs acquis dans un cadre global cohérent.
Alors, si vous souhaitez être initié de façon rigoureuse et étayée à l’approche systémique et stratégique par un praticien confirmé, et selon le domaine qui est le vôtre, nous vous proposons :
Initiation à la thérapie systémique et stratégique (2 ou 3 journées animées par J.-J. Wittezaele)
[ Menu ]
Applications aux organisations et aux entreprises
(Coaching, accompagnement du changement, « audits interactionnels », formation de dirigeants…)
En attendant, nous vous proposons deux séminaires organisés à Arezzo, l’un destiné aux personnes disposant déjà d’une bonne formation de base à l’approche stratégique, l’autre à ceux qui souhaitent découvrir l’approche.
Spécialement pour les coachs, consultants, managers, DRH qui veulent découvrir l’approche…
[ Menu ]
La communication stratégique, un outil d’intégration pour l’enseignement ?
L’école à l’ère de la révolution informatique et de la multiculturalité
L’école doit évoluer. Tout le monde le dit. On ne peut plus enseigner comme on le faisait il y a ne fût-ce qu’il y a 30 ans. Le problème c’est que, comme tout va tellement vite, on a le sentiment qu’on aura toujours une guerre de retard. Alors, au lieu de se lancer dans des changements « ad hoc » pour tenter de contenir la nouveauté pour préserver les valeurs et les missions socioculturelles traditionnelles de l’école, il serait utile de comprendre les tendances générales qui se manifestent aujourd’hui, d’affronter les peurs et d’oser affronter les changements inévitables, de s’imprégner de ces nouveaux processus et de nous préparer à gérer la nouveauté en général plutôt que d’essayer de neutraliser les effets de changements pouvant être éphémères.
Quelle formation pour les maîtres ?
Quels devraient être, selon moi, ces principes nouveaux, cette ossature épistémologique qui pourrait permettre aux enseignants de retrouver le plaisir de transmettre, de former les nouvelles générations tout en prenant en considération les transformations socioculturelles inéluctables, bref, d’acquérir une « souplesse adaptative » efficiente et durable ?
- Des « contenus » aux processus. L’accent de la formation devrait se déplacer des contenus aux processus, aux interactions, aux relations, à ce qui nous relie à ces contenus. Les enseignants devraient pouvoir se former à une vision « organique » de la vie, à l’importance des interactions entre les élèves, aux liens entre les élèves et leurs familles, leur culture. Mais aussi aux interactions qu’ils ont avec les élèves, avec les parents, à la façon dont ils communiquent… bref, ils devraient pouvoir être formés de façon opératoire aux principes de la communication interpersonnelle et à la résolution des difficultés qui peuvent survenir.
- La posture du maître. Que deviennent le rôle et la posture de l’enseignant sans le pouvoir lié aux connaissances ? Si l’enseignement des savoirs de base reste sans doute indispensable, il n’en demeure pas moins qu’à mesure que l’élève grandit et prend de l’autonomie, l’accès aux informations via les medias, internet et les réseaux sociaux prend le pas sur l’enseignement de certains contenus traditionnels. Comment l’enseignant peut-il dès lors légitimer sa position, assumer son rôle de maître et susciter le respect des élèves ?
Le rapport à l’autorité s’est assoupli, les élèves revendiquent un autre type de rapport avec leurs profs, un rapport plus direct, plus « cool », plus respectueux aussi de leurs différences.
On ne demande plus seulement aux maîtres de savoir enseigner, on leur demande aussi de savoir gérer les relations, d’assurer la fonction essentielle de régulation des interactions avec les élèves et leurs familles. Non pas un savoir théorique, mais un savoir opératoire.
- Une vision globale. Apprentissage de la vie en société à travers les interactions plutôt que par un enseignement morcelé en cours séparés, en « matières ». Plutôt que de submerger l’esprit des élèves par une somme de détails laissant entendre qu’une connaissance totale est possible (et préparer ainsi une grande désillusion !), on met l’accent sur les liens, sur les relations, sur une vision globale.
- Aborder les différences de façon intégrative : comprendre et accepter l’autre.
Aujourd’hui, on trouve dans les classes des élèves d’origines culturelles diverses, revêtant des habits différents, pratiquant des religions différentes. Cela peut entrainer pas mal de difficultés pour l’enseignant. Même si des dispositions générales sont prises par les divers établissements scolaires, et qu’une « ligne de conduite » générale peut être décidée par l’ensemble du corps enseignant, il peut arriver qu’un enseignant doive prendre une position face à des propos, des attitudes voire des actes qui peuvent être directement ou indirectement des atteintes à la laïcité ou aux normes culturelles en vigueur chez nous.
Nous proposons donc de faire du dialogue stratégique, un outil d’intégration socioculturelle pour l’enseignement.
Une des missions essentielles de l’école consiste à faciliter les rapports entre les futurs citoyens, à dépasser la défiance, le désir de protection face à la différence, à l’inconnu, à l’autre. Nous pensons que cet apprentissage serait plus efficace s’il procédait par immersion dans le monde de l’autre, par une découverte expérientielle plutôt que par une approche uniquement rationnelle. Etudier l’autre, c’est poser sur lui un regard extérieur, c’est déjà s’en démarquer, s’en séparer, c’est le réduire à certains traits, c’est accentuer le sentiment de différence… Découvrir comment il pense, ce qui lui plait, ses principes, ses croyances, ses peurs et ses ressources, et ce à travers une vraie rencontre, un partage d’expérience, c’est vivre une « expérience émotionnelle correctrice » qui peut faire éclater les stéréotypes, déstabiliser nos croyances infondées. Au lieu de se focaliser sur les différences et renforcer les individualismes, on découvre ce qui nous relie, ce qui fait notre nature humaine commune.
- L’étude de la communication interpersonnelle, l’art de la régulation des relations humaines
Les enseignants ne doivent pas devenir des thérapeutes, bien sûr, mais il serait bon qu’ils puissent acquérir des compétences communicationnelles et relationnelles. Il est temps d’arrêter de penser que la communication est un phénomène secondaire, que chaque enseignant doit se débrouiller comme il peut, que si l’on a des problèmes avec les autres, c’est parce que ces autres sont « méchants » ou « malades ». Les enseignants savent-ils désamorcer les escalades symétriques, sont-ils sensibilisés aux prophéties autoréalisatrices et à leurs effets dévastateurs, savent-ils gérer une provocation, un conflit, des incivilités ? Disposent-ils d’outils et de méthodes de communication, d’une panoplie de conduites diverses et appropriées à différents types de situation ? Leur a-t-on permis d’apprendre à pratiquer l’art de la régulation des relations humaines ?
Intéressé(e) par la communication stratégique ? Ceci est pour vous :
Pour une communication efficace et une bonne gestion des relations interpersonnelles : la communication stratégique (2 journées de formation animées par J.-J. Wittezaele)
[ Menu ]
Ce que tout élève de l’École de Palo Alto devrait savoir (22)
Cela fait maintenant près de 40 ans que je pratique et enseigne l’approche de Palo Alto. J'ai pu constater tout au long de ma carrière que certains principes de base qui fondent l'approche sont encore méconnus et ne sont donc pas intégrés aux interventions de terrain. Les travaux de Gregory Bateson ont permis d’introduire le regard systémique dans les sciences humaines, mais de nombreuses écoles de thérapie familiale ou systémique ont inventé des méthodes de traitement des difficultés relationnelles sans forcément tenir compte des prémisses épistémologiques de la cybernétique. A Palo Alto, ce sont les travaux de l’équipe du Mental Research Institute (le MRI, dont Bateson n’a jamais fait partie) qui ont débouché sur une méthode d’intervention, influencée par l’approche thérapeutique de Milton Erickson et en phase avec les prémisses de la cybernétique de 2e ordre (von Fœrster).
1. Les prémisses et le modèle d’intervention de Palo Alto
Une approche systémique…
L’approche de Palo Alto est issue des recherches qui ont conduit à la naissance de la cybernétique, formalisée par Norbert Wiener vers le milieu du XXe siècle. C’est elle qui a permis de mieux comprendre comment chaque être humain est constamment façonné par ses interactions avec le monde (physique, social et culturel) qui l’entoure. L’anthropologue Gregory Bateson a introduit les principes fondamentaux de la cybernétique dans les sciences humaines et sociales, notamment avec sa « théorie de la double contrainte » (Palo Alto,1956).
La cybernétique, puis la théorie générale des systèmes (23) ont montré que l'individu est en quelque sorte « contrôlé » par les systèmes organisés auquel il appartient ; son comportement est déterminé, bien souvent à son insu, par les interactions et les « règles », souvent implicites, des systèmes organisés dont il fait ou a fait partie.
Par exemple, nous savons à quel point nous avons été modelés par les interactions au sein de notre famille, par la façon dont nous dont on nous a élevés, par les valeurs qui nous ont été transmises etc., mais il en va de même pour l'école, autre système organisé, pour les groupes d'appartenance, les organisations ou les entreprises dans lesquelles nous avons travaillé où travaillons.
L'interaction est donc au centre de l'approche, c'est à dire l'échange d'informations qui détermine la relation entre les individus. On sait aussi, grâce à la théorie de la double contrainte, que la communication est structurée en niveaux et que, dans une famille, l'un des membres peut se trouver pris dans des paradoxes aux conséquences parfois dramatiques (24), notamment s’il est soumis à des messages du type « sois spontané ». On sait aussi que certaines techniques originales, dites « paradoxales » utilisent la structure communicationnelle paradoxale à des fins thérapeutiques.
… et constructiviste !
Mais même si l’individu est modelé par toutes les influences systémiques, il dispose d’une autonomie relative. Au cours de notre vie nous avons été confrontés à de nombreux systèmes différents et chaque individu développe une façon originale, singulière, de percevoir le monde qui l'entoure. De plus, comme le soulignait Gregory Bateson : « l’homme sait qu’il sait ». C’est là que commence la construction: nous inventons un monde extérieur à nous, un monde dans lequel nous habitons, sur lequel nous exerçons un contrôle; nous, en tant qu’ego, commençons à exister. C’est là qu’apparaît la coupure entre l’observateur et l’observé. Comme le souligne Bateson, «le langage ne met l’accent que sur un terme de l’interaction»: nous ne pouvons nous voir nous-mêmes et donc nous voyons le monde comme extérieur à nous. Le dualisme est bien en place: notre propre système de décodage du monde est considéré comme un point de vue de référence, un point de vue absolu, à partir duquel nous pouvons comprendre le reste d’une façon objective. Tout notre univers sera donc «ponctué» à partir de ce point de vue. Donc, comme le dit von Fœrster : « notre perception du monde est notre invention. »
Les choses vont se compliquer encore plus lorsque l’observateur va essayer de s’analyser lui-même. L’observateur regarde l’acteur comme si celui-ci était différent de lui-même.
Nous vivons tous comme si nous étions deux personnes en même temps: nous nous efforçons de nous endormir (qui essaie d'endormir qui?), de nous calmer, d'avoir une érection ou un orgasme, nous nous exhortons à ne pas avoir peur, à nous concentrer, à étudier, à voir le beau côté des choses… Et avec quel succès qui plus est! Et pourtant Dieu sait si c'est là une manière habituelle d'essayer de dépasser certaines difficultés non seulement personnelles mais aussi pour les autres car nous faisons « bénéficier » les autres de ce qui marche tellement bien pour nous: « essaie de rester tranquille», «essaie de ne pas avoir peur de parler en public », «force-toi à t'y mettre!», «essaie de ne plus y penser» (ce qui est sans nul doute un des conseils les plus efficaces qui soit), etc., etc., les exemples ne manquent pas. Cette conscience réflexive conduit inexorablement au dualisme tel qu'il est révélé par le cogito de Descartes.
Comme c'est le cas pour les différentes formes de savoir, le système de pensée de chacun obéit à certaines règles, repose sur certaines prémisses, plus ou moins précises et explicites, qui guident sa façon de décoder le monde et d'y réagir. «Chaque être humain — chaque organisme — construit son savoir en fonction de ses habitudes personnelles, et chaque système culturel, religieux ou scientifique favorise des habitudes épistémologiques particulières. (25)»
Lorsque nous considérons ce que l'on appelle actuellement la «vision du monde» de la personne, cette réalité de deuxième ordre, comme l'appelle Watzlawick, c'est-à-dire les idées que les gens ont sur le monde, sur ce qu'il faut faire pour être heureux, sur la façon dont il faut voir les choses, sur ce qu'il faut faire pour que tout tourne mieux, sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, sur eux et sur les autres, sur la vie, sur la mort, … ce sont là, en fait, des créations personnelles — même si la culture oriente certains principes de construction. Nous vivons en pensant que la vie est comme ça, que si elle n'est pas meilleure, c'est que, malheureusement — et Dieu seul sait pourquoi –, les gens ne voient pas les choses comme nous. Nous avons vécu certaines choses que nous avons tenté de comprendre, dont nous avons cherché à tirer des leçons, nous avons établi certains liens de causalité, certaines règles de fonctionnement des hommes et de nous-mêmes, nous nous appuyons sur certaines croyances, sur certaines valeurs,… et tout cela nous paraît à même de nous aider à faire face à notre avenir.
Pour la plupart des individus, la vie se charge de détruire régulièrement ces constructions fragiles. Car en effet, tout cela n'est jamais qu'une construction chancelante d'anciens repères désormais inutiles. Mais c'est tout ce qu'on a! Du moins c'est l'impression que nous avons tous. Nous croyons que si on nous enlevait cela, alors ce serait le vide total, le néant, la perte de tous nos apprentissages, et que le monde se déroberait sous nos pieds. Et si c'était le contraire… ?
Je ne veux pas dire que ces visions du monde sont mauvaises en soi, elles nous sont utiles pour communiquer, pour échanger avec nos semblables, c'est ce qui apporte de la diversité dans notre monde, c'est ce qui en fait une gigantesque galerie d'art. Le problème c'est que comme nous considérons qu'il s'agit non pas d'une œuvre d'art personnelle mais d'une description objective de la réalité, nous combattons les œuvres d'art des autres. Ce que suggère l’École de Palo Alto, c'est que nous partions de ce premier constat: chacun voit le monde à sa manière et cette vision du monde n'est que cela: une vision, une construction, que cette construction nous a été utile jusqu'ici mais que, peut-être, la vie nous amènera à la modifier si nous voulons continuer à vivre sans trop souffrir.
Cette réalité pouvant être modifiée par nos interactions, c’est un des aspects sur lesquels l’intervenant peut agir lors de ses contacts avec son ou ses clients : c’est le domaine des recadrages stratégiques.
L’intervention stratégique : pourquoi comprendre ne suffit pas pour changer…
On sait depuis Freud que le comportement humain est loin d’être déterminé par la raison, et que la volonté (« cette chimère » selon Kant) n’est pas suffisante pour amener quelqu’un à abandonner des conduites non désirées (ruminations morbides, anxiété, compulsions, procrastination, etc.) et à concrétiser d’autres modes d’interaction plus satisfaisants. Cependant, notre culture imprégnée de cartésianisme nous encourage à penser, encore et encore, que si nous arrivons à « comprendre » ce qui nous arrive, nous pourrons alors faire ce qui est nécessaire pour obtenir le soulagement espéré. Bien souvent, les intervenants le pensent autant que les clients ou patients en quête de solutions à leurs difficultés. Grâce à leur position « méta », les intervenants systémiciens imaginent que la prise en compte d’une vision plus globale leur permettra d’éclairer les acteurs et, dès lors, leur fournira les clés du changement. L’approche de Palo Alto, ou plutôt les travaux de l’équipe du MRI ont largement pourfendu cette idée. Ils considèrent que leurs interventions doivent « toucher le cœur » de leurs clients, c’est-à-dire provoquer une réaction émotionnelle capable de déstabiliser l’homéostasie non désirée du système.
S’il est possible de poser un regard extérieur sur un système ou une interaction, et si ce recul permet de déceler les « processus » relationnels qui se jouent à un moment donné entre les partenaires, cela ne permet pas encore de savoir comment mener à bien une intervention de changement avec de bonnes chances de succès. On peut comprendre, comme je l’ai dit plus haut, que dans une interaction conflictuelle, chaque acteur ponctue l’interaction de son point de vue et se voit comme « répondant » au comportement de l’autre, sans percevoir la façon dont ses réactions induisent les réponses de son interlocuteur. La position extérieure de l’intervenant systémicien permet donc de dépasser cet « aveuglement individuel » et d’acquérir un supplément d’information sur l’état de la relation qui pourrait permettre aux acteurs de prendre conscience de leur « biais perceptif » et de pouvoir dès lors modifier leur interaction dysfonctionnelle. Mais encore faut-il que cette vision extérieure d’ «expert » soit acceptée par les acteurs du terrain, et cela ne va pas de soi.
Pour prendre un exemple simple de la construction d’une relation conflictuelle, imaginons un manager qui a le sentiment qu’un de ses collaborateurs n’a pas un rendement suffisant.
Il peut alors se mettre à l’observer de plus près pour « vérifier son hypothèse ». Il se rend régulièrement dans le bureau de son subordonné pour se faire une idée plus précise de ses manquements ; il regarde par-dessus son épaule, lui pose des questions sur son travail, lui fait quelques remarques sur sa baisse de régime « pour le stimuler et l’encourager » (de son point de vue). Le collaborateur, quant à lui, se demande alors ce qui peut bien amener ce contrôle inhabituel, et peut se sentir traité différemment des autres. Il vit péniblement ces visites impromptues et se pose des questions : « Qu’est-ce qu’il me veut ? J’ai l’impression qu’il me cherche, qu’est-ce qu’il a dans la tête ? » Cela entraîne chez lui un certain stress et de la méfiance. Lorsque le manager vient le voir, il se montre donc très fermé, dit que tout va bien et qu’il ne voit pas pourquoi il fait l’objet de ce surcroît d’attention. Percevant la réaction défensive de son collaborateur, le manager peut se dire que celui-ci essaie effectivement de lui cacher quelque chose, et il multiplie les contrôles « pour en avoir le cœur net ». Plus il se sent contrôlé, plus le stress devient important pour l’employé ; il y pense de plus en plus, en parle autour de lui pour chercher une information qui lui permettrait de comprendre pourquoi il est soumis à ce contrôle excessif. Lui-même commence à être envahi par les ruminations liées à ses hypothèses de discrimination. La tension monte entre les deux hommes. Le manager ne comprend pas la résistance de son collaborateur, le trouve de plus en plus fuyant, désagréable et le suspecte de vouloir l’empêcher d’effectuer son travail. Après tout, c’est lui qui devra rendre des comptes si le travail n’est pas fait correctement, alors il doit savoir ce qui se passe vraiment. L’autre, s’attendant désormais à ce contrôle permanent, devient tellement préoccupé qu’il n’arrive plus à travailler correctement : il fait des réflexions désagréables à son manager, ne répond plus aux questions de ce dernier, et se prépare à aller trouver son médecin ou son syndicat, voire le service de prévention du harcèlement si l’entreprise en est pourvue.
Dans cet exemple, il est clair que si on demande leur avis à chaque partenaire de l’interaction, ils décriront leur propre perception de la situation : le manager dira « il m’empêche de faire mon travail, du coup je risque des ennuis avec ma direction, alors je suis obligé d’être plus attentif vis-à-vis de lui », alors que le collaborateur pourrait déclarer : « Mon manager veut se débarrasser de moi et me harcèle dans mon travail, ce n’est plus possible de continuer comme ça ! »
Un observateur systémicien peut appréhender la circularité du processus, ce qui lui permet de percevoir une « vérité » qui échappe à chacun des acteurs. Il pourrait se dire que sa position « méta » par rapport aux deux visions individuelles pourrait permettre à chacun de « voir » le jeu interactionnel qui les relie, et d’abandonner alors leur vision linéaire individuelle et conduire à une désescalade. Mais malheureusement, c’est compter sans l’aspect émotionnel de ce processus ! Les deux hommes s’en veulent beaucoup lorsque le processus dure depuis un certain temps. Chacun s’est mis à étiqueter l’autre : pour le manager, son collaborateur est (par exemple) un tricheur qui veut en faire moins que les autres, et il faut absolument sévir ; pour le collaborateur, son chef est un pervers qui se venge sur lui de ses frustrations ! (Ou quelque chose d’approchant, chaque situation étant spécifique.) Ces deux façons de décoder le problème sont donc en opposition avec la vision interactionnelle qui semble renvoyer les deux opposants dos à dos, ou en tout cas de vouloir partager les responsabilités.
Lorsque l’observateur va leur proposer son analyse circulaire, il risque donc fort de se heurter à une résistance farouche de la part des deux acteurs, et, en plus, de susciter la méfiance à son égard, chacun pensant en son for intérieur : « il n’a rien compris ! » C’est d’ailleurs là que se situe la difficulté récurrente rencontrée dans les interventions de médiation : toute explication qui ne correspond pas à la façon dont les acteurs vivent la situation risque d’être rejetée et même provoquer une amplification de leur point de vue. Comme le souligne, de façon imagée, le poète taoïste Lin Yutang : « Il n’y a pas de plus grand voleur au monde que celui qui nous vole notre liberté de penser. Privés d’elle, nous pouvons tout aussi bien nous remettre à quatre pattes. C’est pourquoi, selon les paroles de Mencius, les gens seront irrités par ce voleur, en proportion de son mépris pour eux. Ils le haïront d’autant plus qu’il leur ôtera plus. Et comme rien n’est aussi précieux, personnel et intime que nos croyances intellectuelles, morales ou religieuses, il n’est pas de plus grande haine que celle provoquée par l’homme qui nous ôte le droit de croire ce que nous croyons. » (Lin Yutang: L’importance de vivre.)
Du coup, pour l’intervenant qui a pour mission d’amener un changement, il sera nécessaire de procéder de façon stratégique. S’il veut avoir la confiance des interlocuteurs, il devra d’abord rejoindre chacun dans sa position, c’est-à-dire la comprendre (pas la partager) et l’accepter. Ce n’est que dans un 2e temps que l’intervenant pourra la faire évoluer grâce à ce que nous appelons les recadrages ou, de façon plus globale, le « dialogue stratégique ».
2. L’approche de Palo Alto est-elle culturellement indigeste ?
L’approche de Palo Alto repose sur des prémisses qui, dans l’ensemble, restent largement étrangères à la façon occidentale d’aborder le comportement humain et la résolution de problèmes, façon qui est ancrée dans l’inconscient collectif, et notamment dans l’entreprise.
L’épistémologie systémique et ses implications pratiques remettent en question certains piliers de notre pensée : notre conception de la réalité, de la vérité, de l’objectivité, notre compréhension du comportement humain, du changement, et, par conséquent la manière d’envisager une intervention concrète de changement sur le terrain.
Nous vivons dans une culture qui est toujours imprégnée de la vision linéaire et expérimentale telle que Descartes l’a formalisée dans son Discours de la méthode.
Nous avons tendance à penser de façon linéaire ( à chercher « la cause », le coupable…) et éprouvons des difficultés à comprendre la circularité des phénomènes vivants, l’importance de la dynamique de leur organisation, du mouvement, du changement comme base de la vie. Nous pensons que nous pouvons percevoir la réalité telle qu’elle est si nous observons les phénomènes de façon extérieure, neutre et objective, et qu’avec un peu de bonne volonté, chacun pourrait s’accorder sur ce qu’est La Vérité. Nous avons beaucoup de réticence à accepter que notre regard sur le monde repose sur une théorie, la plupart du temps implicite et inconsciente, qui l’oriente et le formate. En tant qu’intervenants « experts », nous nous efforçons alors d’imposer ce regard à nos clients, de les convaincre de voir les choses « comme il faut » (en fonction de notre schéma explicatif), pour résoudre leurs problèmes. Nous pensons toujours qu’un bon diagnostic est le premier pas vers une solution optimale à une difficulté, et que l’on peut planifier les différentes étapes d’un changement sur base de ce diagnostic. Bref, nous montrons beaucoup de réticence à abandonner l’approche expérimentale, « objective », au profit d’une approche pragmatique et expérientielle.
D’une manière globale, la science occidentale est une vaste entreprise de modélisation : nous élaborons des plans de l’action idéale à mener, plans que nous projetons sur le monde et que nous faisons « entrer dans les faits ». Nous restons accrochés à notre façon « rationnelle » de procéder :
• Analyser le phénomène de l’extérieur ;
• Poser un diagnostic sur un état de la situation ;
• Définir un plan d’actions correctrices ;
• L’imposer sur les faits. Et si nous rencontrons de la résistance, alors nous insistons, expliquons, essayons de convaincre, etc., mais nous ne remettons pas le modèle en question.
Les mythes de l’objectivité, de La Vérité, de La Réalité
Depuis Heisenberg et son principe d’incertitude, les sciences dures ont renoncé au grand rêve de l’objectivité. On sait que l’observateur modifie déjà le phénomène observé et que l’on ne peut en donner, au mieux, qu’une description déjà filtrée par les limites de nos sens.
La cybernétique de 2e ordre a aussi montré que l’on ne peut se contenter d’analyser les systèmes « objectivement de l’extérieur » ; l’observateur ne peut pas être « neutre » car ses observations dépendent des prémisses qui orientent son propre regard. Comme le dit Gregory Bateson : « On appréhende la réalité grâce à une théorie qui nous permet de la comprendre, et chacun de nous a sa propre théorie, qu'il a construite par ses expériences de vie. » Une « explication » révèle donc la théorie de celui qui explique, que celle-ci soit une théorie standardisée ou strictement personnelle. Pour les cybernéticiens, l’observateur doit donc s’inclure dans le phénomène qu’il cherche à comprendre : « Si j’obtiens cette réponse, quelle question ai-je posé ? »
De plus, l’approche systémique a montré les interventions dans les affaires humaines sont des activités qui portent sur des « objets » qui vivent et qui réagissent, il s’agit donc de processus indéterminés sur lesquels on ne peut plaquer un plan d’action prédéfini de façon théorique.
Un choc de visions du monde
Pour mieux apprécier les différences entre ces deux paradigmes, le paradigme systémique et l’approche expérimentale d’objectivation, je vous propose une citation de Heinz von Fœrster, l’un des créateurs de la cybernétique de 2e ordre :
« Suis-je distinct de l’univers ? Si oui, alors quand j'observe, j'observe comme à travers le trou d'une serrure un univers en évolution.” “Fais-je partie de l’univers ? Alors, à chacun de mes actes, je change à chaque fois moi-même et l'univers.” Chaque fois que je réfléchis à cette alternative, je suis toujours aussi surpris par la profondeur de l'abîme qui sépare les deux mondes fondamentalement différents que peut engendrer un tel choix : soit me voir comme citoyen d'un univers indépendant de moi, dont je peux éventuellement découvrir les normes, les règles et les coutumes ; soit me voir comme participant à une entreprise dont nous inventons chaque jour les coutumes, les règles et les normes. »
Nous nous trouvons donc au croisement de 2 visions du monde aux implications très différentes…
Et donc en entreprise…
Lorsque l’intervenant formé à l’approche de Palo Alto doit intervenir dans une organisation ou une entreprise, cela génère une grande incompréhension chez le commanditaire. L’intervenant entre en contact avec des personnes (patron, manager, DRH, cadres, employés, etc.) qui s’attendent sans doute à une méthode nouvelle, voire disruptive, mais qui respecte leurs prémisses implicites et qui leur propose un plan d’action qui tienne compte de leur analyse de la situation :
• Soit on attend de lui qu’il règle un problème qu’un autre « expert » (ou un audit) a défini de l’extérieur (venir former les gens à la communication, par exemple (26) );
• Soit on lui dit avec qui et comment il doit travailler ;
• Soit on lui demande de dire ce qu’il va utiliser comme techniques ou combien de temps va durer l’intervention…
Tout cela alors qu’il n’a pas encore pu apprécier les potentialités de la situation à traiter, ce qu’il ne pourra faire qu’en y intervenant : « Si tu veux voir, apprends à agir », comme disait encore pertinemment von Fœrster.
Bien souvent, pour que leur proposition d’intervention puisse être acceptée, il devront dénaturer leur approche. Il arrive que cela fonctionne quand même mais l’intervenant voit ainsi se restreindre la liberté de manœuvre nécessaire à une intervention efficace.
Nous pensons que chaque entreprise est unique et que c’est en partant de ses ressources propres et en tenant compte des caractéristiques de ses personnels que l’on peut lever les blocages. Notre approche n’est pas normative, elle ne préconise pas un type de fonctionnement idéal à atteindre mais vise à faire en sorte qu’elle trouve le mode d’adaptation au contexte qui lui convient.
De même l’approche de PA adapte son mode d’intervention au problème rencontré et à l’esprit de l’entreprise. On peut dire qu’il s’agit d’interventions « sur mesures ». Il s’agit de mobiliser les forces à l’œuvre (mais qui s’avèrent inefficaces) pour qu’elles deviennent plus efficaces dans le contexte. Pour ce faire, on ne peut afficher un modèle ou des techniques qui ont pu faire leurs preuves ailleurs mais l’on doit investiguer les conditions spécifiques du ou des blocages pour redonner de la fluidité au fonctionnement de l’ensemble. Pour nous, cette liberté de manœuvre est nécessaire pour pouvoir utiliser le « potentiel de la situation » et arriver à des solutions concrètes et appropriées.
Avant d’envisager la méthode d’intervention de Palo Alto, je voudrais citer le philosophe chinois Zhao Tingyang qui me paraît bien décrire la différence entre le « dialogue stratégique » (le processus d’intervention selon Palo Alto), et les approches classiques :« Dans un dialogue occidental typique, on recherche avant tout l’argument logique apte à produire une vérité. Les Chinois, eux, préfèrent une négociation pragmatique dont l’aboutissement est une idée réciproque bénéficiant aux deux parties. […] En un sens, la philosophie chinoise est pragmatique depuis ses origines. Elle s’est toujours focalisée sur les relations plutôt que sur les individus. En conséquence, elle cherche à promouvoir un type de relation humaine tourné vers la maximisation des bénéfices réciproques en vue du bonheur. La philosophie occidentale, en revanche, recherche une vérité universelle pour chaque individu. » (Zhao Tingyang)
(Il est intéressant de remarquer que les prémisses systémiques nous rapprochent de la philosophie orientale qui a toujours considéré que la relation est première et que l’individu se construit à travers ses interactions. Cela aussi peut sembler indigeste à certains !)
3. L’intervention stratégique selon Palo Alto
À partir de ces prémisses systémiques et constructivistes, l'équipe du MRI de Palo Alto a élaboré un modèle d'intervention : la thérapie brève. Ce modèle a été enrichi notamment par les apports des représentants officiels du MRI pour l’Europe francophone (l’équipe de l’Institut Gregory Bateson) et pour l’Italie (Giorgio Nardone). Il est utilisé non seulement pour le traitement des problèmes psychiques et relationnels, mais beaucoup de coachs et de consultants l’appliquent aux problèmes rencontrés en coaching ou même aux problèmes plus larges que l’on rencontre dans les entreprises ou les organisations.
Il s’agit d’une méthode pragmatique et expérientielle.
Je n'ai bien sûr pas le temps de développer ici la méthode d’intervention dans sa complexité (27), je me contenterai d’en présenter les étapes essentielles et originales. Face à une situation problématique, qu’il s’agisse d’une relation conflictuelle, d’un problème personnel ou professionnel, ou même d’une entreprise ou d’une organisation en difficulté, l’intervenant va utiliser :
• Toutes les ressources et la dynamique du système concerné : le « potentiel de la situation » ;
• Un mode d’interaction stratégique avec ses clients : le « dialogue stratégique » ;
• Sa propre expérience en matière de communication stratégique acquise au fil de ses interventions précédentes. Il va, en quelque sorte, « entrer dans la danse » avec ses interlocuteurs.
Le « potentiel de la situation »
Aborder une nouvelle situation pour y intervenir est toujours un moment privilégié ; nous sommes à chaque fois confrontés à une forme originale d’existence, d’organisation, à une forme singulière d’entreprise. En tant qu’agent de changement, notre action consiste à apporter un soulagement aux difficultés vécues au sein de ces systèmes. Il importe donc que l'intervenant puisse le plus vite possible mettre en œuvre une stratégie d'action orientée vers cet objectif. L’approche systémique et stratégique de Palo Alto considère que la situation génère de la souffrance parce que tous les efforts qui sont faits pour trouver des solutions la ramènent à chaque fois au point de départ. L’histoire tourne en boucle et forme ce que les cybernéticiens appellent un équilibre non désiré qui empêche une évolution favorable de la situation.
Dans cette histoire, on trouve bien sûr, des acteurs, les différents protagonistes : le coaché, le manager, le DRH, des collègues, etc. Ces différents personnages sont dotés d’un « caractère » avec ses originalités, ses faiblesses, ses beaux côtés, ses valeurs, ses opinions… Et tous ces personnages se croisent, s’attirent, se repoussent, forment des coalitions. Ils ont des ressources mais aussi des limites, des blocages, des positions tranchées, des rigidités… Et ils ont des intentions, des désirs, des projets… qui ne vont pas forcément dans le même sens. Et ils essaient de se mettre d’accord, de se convaincre et… ça ne marche pas comme ils voudraient. Et cela entraîne des déceptions, des frustrations, des colères, des tristesses, des dépressions, des comportements bizarres ou même insensés. Et ils s’accusent l’un l’autre et les rancœurs s’accumulent. Lorsque, finalement, quelqu’un décide de demander de l’aide, plus personne ne sait vraiment définir ce qui ne va pas.
L’intervenant devra entrer dans le système et découvrir la cohérence interne de ce système dysfonctionnel. Pour ce faire, il lui faudra repérer les éléments clés et les interactions sur lesquelles il pourra agir pour faire évoluer le système vers un état et un fonctionnement plus satisfaisants.
Les questions doivent éclaircir :
a. Le problème (ou l’objectif) tel qu’il est perçu par le client de façon concrète, et la façon dont il fonctionne (ou les caractéristiques de l’objectif).
Il s’agit de faire émerger la source du dysfonctionnement : qu’est-ce qui ne va pas ? Dans quelles circonstances ? (Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ?)
b. Les tentatives de solution volontaires et involontaires ainsi que leurs conséquences.
c. Les éventuelles exceptions au problème.
« Y a-t-il déjà eu des exceptions ou les choses ont-elles toujours été comme ça ? » Si des exceptions sont signalées, l’intervenant va voir si elles sont reproductibles (ou comment elles pourraient l’être).
Le travail de l’intervenant commence dès le premier échange notamment avec le commanditaire de l’intervention : qu’est-ce qui motive sa demande ? Comment voit-il le problème ? Qu’attend-il comme résultat ? Les réponses à ces questions permettront déjà à l’intervenant de se faire une première représentation de la situation à traiter et des premières personnes à rencontrer.
Tenir compte de la réalité de chacun des acteurs
Les difficultés de l’organisation ou de l’entreprise sont vécues différemment par les différents acteurs du système. Certains s’en accommodent, courbent l’échine voire s’en réjouissent, alors que d’autres en souffrent. Parmi ces derniers, certains sont paralysés ou se sentent impuissants, d’autres continuent à essayer de se battre pour améliorer les choses. Et chacun comprend le problème à partir de son point de vue, et y va de sa propre explication causale. Pour l’un c’est : « le directeur qui ne fait pas son boulot », pour un autre : « c’est le manque de moyens ou de personnel », pour certains : « c’est depuis l’arrivée de ce nouveau manager », pour d’autres encore : « je n’en sais rien, ça a toujours tourné comme ça, ou ce n’est pas mon affaire, moi je fais mon boulot », etc. C’est l’équilibre global du système que l’intervenant doit déstabiliser pour lever les blocages. Pour ce faire, s’il ne veut pas supporter seul la démarche du changement et donc être confronté à la résistance du système, il doit pouvoir utiliser les ressources disponibles et d’abord repérer les personnes qui essaient encore de trouver une solution, un soulagement
Avec qui travailler ?
Il n’est pas utile que l’intervenant travaille avec toutes les personnes impliquées, au contraire, il va stratégiquement éviter de dépenser de l’énergie en pure perte avec celles ou ceux qui ne voient aucun intérêt à résoudre le problème puisqu’elles en retirent des avantages ou souhaitent, pour des raisons qui leur sont personnelles, maintenir l’équilibre dysfonctionnel. Il va donc repérer au plus vite ce que nous appelons « le système pertinent », c’est-à-dire l’ensemble des personnes (parfois une seule !) qui s’efforcent encore de trouver une solution. Ce sont elles qui vont constituer les meilleurs leviers de changement parce qu’elles se trouvent loin de leur point d’équilibre, qu’elles souffrent de la situation et qu’elles souhaitent que les choses changent.
C’est ce que l’équipe du MRI appelait le ou les « clients » de l’intervention.
L’intervenant va questionner les acteurs de terrain pour obtenir des réponses aux questions suivantes :
• Qui manifeste les difficultés ? (Le problème ou les symptômes)
• Qui est impliqué par le problème ? En quoi ce problème le concerne-t-il ?
• Qui est actif dans sa régulation ou impliqué dans la recherche d’une solution ?
• Qui est prêt à se mobiliser pour faire évoluer la situation ? (Résistances éventuelles)
Par exemple, un manager qui se plaint du travail d’une équipe pourrait constituer un bon levier de changement ! D’une part parce qu’il a sans doute un intérêt personnel à ce que le problème s’arrête (il peut risquer son poste si ce n’est pas le cas), d’autre part parce qu’il a sans doute déjà déployé de nombreux moyens pour arranger les choses et qu’il est important de les connaître pour savoir ce qui ne marche pas !
Il faut d’ailleurs signaler que bien souvent le commanditaire (directeur, manager, etc.) considère qu’il est extérieur au problème ; il rencontre l’intervenant pour lui faire part de son diagnostic et, parfois, indiquer ce qui lui paraît nécessaire pour résoudre le problème. Pour lui, son rôle s’arrête là, et il s’attend généralement à ce que l’intervenant exécute le travail ainsi grossièrement défini en utilisant les moyens les plus adéquats.
L’intervenant stratégique ne pourra se contenter de cela. Pourquoi ? D’abord parce que, comme tous les protagonistes, le commanditaire voit les choses de son propre point de vue – donc bien souvent à partir d’une logique linéaire, et surtout parce qu’il ne peut apprécier le rôle qu’il joue lui-même dans la dynamique dysfonctionnelle. Pour l’intervenant systémique et stratégique, il est important de ne pas se retrouver pris dans une forme d’injonction paradoxale : « J’ai un problème avec eux, aidez-les ! (28)»
Déterminer « le problème » de façon concrète
L’approche de Palo Alto est non normative, c’est-à-dire qu’elle ne définit pas les problèmes en fonction de normes extérieures (des « critères de normalité » définis de façon absolue) mais uniquement de manière pragmatique, du point de vue de la personne concernée. Par exemple, dans un conflit, on ne va pas chercher à savoir qui a raison ou tort, si l’une des personnes concernées est « objectivement » anormale ou non, ou si son comportement correspond ou non aux normes généralement acceptées dans notre culture (29). On cherche seulement à comprendre ce qui la dérange elle, de son propre point de vue. Pour éviter toute mauvaise interprétation, l’intervenant fait préciser les formulations trop abstraites du problème (par exemple les explications que les acteurs en donnent) en demandant aux protagonistes de concrétiser leurs analyses par des exemples concrets d’interactions problématiques.
Cet aspect non normatif et non pathologisant du problème est souvent rejeté par notre culture qui essaie de rassembler autour des positions idéologiques dominantes. Pour nous, le harcèlement, le burn-out, le non-respect des normes de sécurité, etc. peuvent prendre des formes très différentes en fonction des personnes concernées, et nécessiter des modes d’intervention spécifiques.
Repérer les « tentatives de solution » des clients
Pierre angulaire de l’intervention stratégique de Palo Alto, la notion de « tentatives de solution » qui indique clairement la filiation de l’approche avec la cybernétique. Une interaction ne se régule pas à la satisfaction des acteurs parce chacun réagit aux comportements de l’autre d’une façon qui non seulement ne calme pas le jeu mais finit par l’envenimer. En général parce que chacun interprète mal (mais « logiquement » de son point de vue) le comportement de son partenaire. Chacun est persuadé qu’il a raison de faire ce qu’il fait et que c’est l’autre qui ne veut pas comprendre. Bien souvent d’ailleurs, lorsque le conflit est bien installé, les deux partenaires ont le sentiment d’avoir épuisé tous les moyens possibles pour tenter d’arranger les choses : malgré tous mes efforts, il ou elle ne veut pas accepter les choses telles qu’elles sont ! Il est intéressant de remarquer la circularité du processus de perception/réaction : comme je perçois les choses comme ça, il est logique que je j’agisse comme je le fais ; et les résultats de mes actes, c’est-à-dire la réaction qu’ils provoquent de la part de l’autre, confirme ma perception.
La vision du monde d’une personne constituant un système homéostatique comme je l’ai souligné plus haut, donc résistant aux tentatives d’influence directe, l’intervenant qui veut modifier les interactions d’un client cherchera surtout à l’amener à changer de comportement. S’il agit autrement, le feed-back sera différent et modifiera sa perception de la situation. « Si tu veux voir, apprends à agir » comme le dit von Fœrster.
Tout le travail de l’intervenant consiste à conduire son client à prendre le contrepied de son mode de réaction habituel lorsqu’il est confronté au problème.
En affirmant cela, j’ai bien conscience de soulever des questions multiples auxquelles je ne pourrai pas répondre dans ce petit texte : pourquoi les personnes recourent-elles encore et encore à une réaction qui ne marche pas ? Pourquoi faire l’inverse permet-il de sortir du problème ? N’existe-t-il pas d’autres façons d’en sortir ? Concrètement, qu’est-ce que «faire un virage à 180° » ? Comment amener un client à renoncer à ses tentatives de solution ? Etc, etc. Toutes ces questions sont pertinentes et méritent un développement, je renvoie donc les lecteurs intéressés aux ouvrages de l’équipe de Palo Alto et de leurs disciples.
Disons ici que c’est la découverte de l’importance de ce processus qui a permis à l’équipe de Palo Alto de formaliser un mode d’intervention non normatif : c’est le client lui-même, à travers ses tentatives de solution, qui indique à l’intervenant la voie à suivre pour lui permettre de sortir de son problème. C’est également la partie la plus technique de l’approche de Palo Alto, notamment parce qu’elle implique parfois le recours à des moyens paradoxaux pour arrêter les tentatives de solution, comme le montre l’exemple suivant.
Une de mes patientes est venue me voir parce qu'elle ne supportait plus les contrôles incessants de sa cheffe. Celle-ci pouvait débarquer dans le bureau, un Open Space où travaillaient une dizaine d’assistantes sociales, plus de 40 fois en une matinée. Après avoir essayé pendant des mois de lui dire qu'il n'était pas nécessaire qu'elle vienne contrôler leur travail aussi souvent - ce qui augmentait la défiance de la cheffe - les pauvres n’en pouvaient plus et elles avaient donc délégué une des leurs pour venir chercher une solution stratégique. Je lui ai proposé d'aller trouver leur cheffe et de lui demander si celle-ci pouvait passer plus souvent parce qu'elles étaient très rassurées que quelqu'un les aide et que cela facilitait leur travail. La cheffe lui a répondu qu'elle n'avait pas que ça à faire et qu'il était grand temps qu’elles soient autonomes dans leur travail. En attendant, elle ne passait plus que rarement dans l'Open Space et les AS furent soulagées.
Le dialogue stratégique
Je l’ai dit plus haut, une intervention stratégique commence dès le premier contact entre l’intervenant et le commanditaire. Calibré pour arriver à saisir la dynamique systémique du problème et les éléments principaux du potentiel de la situation, l’intervenant va alors rencontrer les différents acteurs mobilisables, comprendre les différents points de vue et user de son influence pour fluidifier les interactions en utilisant le dialogue stratégique.
Le dialogue stratégique est un processus de transformation active de la perception de la situation problématique par le client en une nouvelle formulation ouvrant des possibilités de changement. La situation problématique est directement mise en relation avec la façon dont la personne y réagit: ce qu’elle ressent, fait, dit et pense lorsqu’elle y est confrontée. (« Donc, quand vous avez le sentiment que votre collaborateur ne travaille pas bien, vous vous dites qu’il n’y a que la peur du gendarme qui pourra le secouer, et vous vous pointez dans son bureau pour lui mettre la pression… C’est bien ça ? ») La circularité entre le problème et les tentatives de solution est soulignée et mise en relation avec la « logique »du patient. (« Et quand vous faites cela, avez-vous le sentiment que c’est efficace ? Il se met effectivement à mieux travailler ? »)
Les questions stratégiques ne sont pas seulement des outils de connaissance mais des véhicules de changement: elles provoquent, chez la personne égarée dans ses perceptions et ses conduites dysfonctionnelles, de nouvelles façons de percevoir et de réagir à la réalité. L’idéal étant que le patient, par ses réponses aux questions du thérapeute, ait le sentiment de découvrir lui-même sa réalité dysfonctionnelle, car pour citer Pascal : « On se persuade mieux, pour l'ordinaire, par les raisons qu'on a soi-même trouvées, que par celles qui sont venues dans l'esprit des autres. »
L’intervenant peut également agir de façon stratégique sur la vision du monde des clients, en utilisant un langage analogique qui « parle au cœur » de ses clients : suggestions indirectes, images, métaphores, histoires, maximes, citations… Ces « recadrages » auront tous pour objectif de détourner le client de ses tentatives de solution.
Affronter l’incertitude en « entrant dans la danse »…
La tradition scientifique occidentale requiert une distance marquée entre l’observateur et la chose observée, une objectivation de l’observation ; celle-ci doit être neutre, désintéressée, détachée de toute participation de celui qui observe. Elle cherche à abstraire, à dégager des formes, des idées. Par contre, l’approche du processus réclame une attitude différente de la part de l’intervenant : pour saisir la dynamique du processus, il faut en quelque sorte la ressentir à mesure qu’elle s’actualise, en épouser le mouvement, le flux, le déroulement temporel (et pas seulement spatial).
Durant les entretiens, l'intervenant ne cherche pas à abstraire, donc à interpréter, mais à se familiariser avec ce qui se déroule dans la vie de ses interlocuteurs, de façon à pouvoir en appréhender l'évolution, à saisir les germes des transformations qui s’annoncent, des souffrances qui se cristallisent et qui forment des nœuds relationnels qui bloquent la circulation de l’information, qui empêchent le déploiement des tendances, etc. Se laisser imprégner de la dynamique des relations, c’est suivre pas à pas l’enchaînement des événements, c’est faire sienne la logique relationnelle, c’est comprendre comment une chose en entraîne une autre.
L’intervenant stratégique va dès lors « concentrer son attention sur le cours des choses, tel qu’il s’y trouve engagé, pour en déceler la cohérence et profiter de leur évolution. » C’est ainsi que François Jullien décrit l’action du « sage » chinois lorsqu’il est confronté à une situation conflictuelle. Encore une fois, la similarité entre l’approche de l’efficacité dans la pensée chinoise et l’approche de Palo Alto est frappante.
L’empathie stratégique
L’intervenant ne doit pas seulement comprendre et accepter la vision de son interlocuteur, il doit pouvoir la faire évoluer pour qu’elle lui permette de renoncer à ses tentatives de solution et s’ouvrir à un autre type d’interaction. Il ne doit pas se contenter d’être empathique, il doit pouvoir briser cette empathie lorsque le client aborde ses tentatives de solution. C’est ce que nous appelons l’empathie stratégique.
L’approche systémique et stratégique se distingue l’approche rogérienne par la façon dont l’intervenant réagit aux propos de son client. Nous ne nous contentons pas de nous situer dans le référentiel de l’autre par un comportement en miroir ou en écho. Nous pensons que cette attitude risquerait de conduire l’intervenant à refléter les tentatives de solution du client et donc à les renforcer, en les validant par son approbation tacite, et à risquer de s’y perdre comme lui.
L’intervention stratégique se situe justement dans l’attitude paradoxale, la rupture de continuité entre :
— Le comportement empathique de l’intervenant durant la phase d’élucidation du problème et de verbalisation de la logique de la vision du monde du client, et
— La réaction (verbale et/ou non verbale) stratégique de l’intervenant qui indique, implicitement ou explicitement, la possibilité d’une conclusion totalement en opposition avec celle du client. Cette réaction crée une sorte de dissonance cognitive et émotionnelle que le patient doit résoudre en abandonnant ses prémisses inadéquates.
Une des « règles du jeu stratégique » que le thérapeute doit inclure dans le processus de changement est que la réaction empathique doit être inhibée à chaque fois que le client recourt à ses tentatives habituelles pour essayer de résoudre son problème. Il existe de nombreuses manières d’arriver à ce résultat. Par exemple, l’intervenant peut exprimer de l’étonnement de façon non verbale ou verbale : « Donc, à chaque fois que vous essayez de convaincre votre collègue, il se braque davantage…humm… Et vous continuez à le faire… ? » Ou encore, il peut devancer le récit du client en tirant lui-même la conclusion inévitable : « … Oui, je vois, alors à chaque fois que vous voulez que votre secrétaire arrête de consulter son Smartphone, vous le lui signalez vertement, et, bien sûr, comme elle se sent traitée comme une adolescente à qui on fait la morale, elle n’a plus qu’une envie, c’est de transgresser vos demandes ! Et, après un petit arrêt, disons « de convenance », elle s’y remet de plus belle ! » Tout cela dit de manière bienveillante, et non ironique, de façon que le client se sente « humainement » moqué, pris en défaut d’une réaction fréquente, qui semble logique au sens commun, mais qui se révèle régulièrement contre-productive.
Une fois calibré, l’intervenant pourra, le plus « spontanément » du monde, commenter les tentatives de solution par diverses réactions, regard interrogatif, froncement de sourcils, marque d’étonnement, … et marquer ainsi des failles dans la vision du monde du client, dans sa « logique » personnelle.
Ces ruptures d’empathie stratégiques constituent des moments clés du processus de changement. La « bienveillance » de l’intervenant étant ancrée dans le questionnement empathique, ces ruptures créent les conditions d’une double contrainte thérapeutique pouvant déboucher sur des solutions créatives.
Le « calibrage » de l’intervenant
L’intervenant cherche à s’imprégner de la logique implicite et latente du processus en en observant les actualisations continuelles, en s’en imprégnant pour mieux en appréhender le devenir. « Cette connaissance acquise à travers la familiarité d’un déroulement et qui permet d’être toujours prêt à débuter l’élément suivant (le tracé ou le geste à venir).30»
Ce type de connaissance ne réclame pas d’approche sophistiquée ; au contraire, elle demande un dépouillement de l’observateur de toute théorisation préalable qui pourrait orienter l’observation. L’intervenant ne dispose pas d’une connaissance absolue qui ferait de lui un expert a priori des situations que les patients lui relatent : il ne peut arriver à saisir le sens de ce que les clients vivent qu’en s'imprégnant de leur contexte de vie. De plus, toute connaissance ne sera jamais que relative car l’observateur fait lui-même partie des systèmes étudiés. Il n’a pas le pouvoir de s’abstraire complètement de son observation et se contentera d’épouser au maximum la vision de l’autre en établissant une interface mutuellement acceptée, une base compatible entre le client et lui, et qui servira de levier pour faire évoluer la situation dans le sens attendu par le patient.
A l'opposé, celui qui approche des situations d'aide avec l'idée qu'il va résoudre tous les problèmes en faisant entrer le patient dans le cadre qu'il a choisi d'utiliser risque fort de se retrouver très vite bloqué dans les interactions avec ses patients, de devenir harcelant, de se montrer impatient, bref, de perdre le contact avec les personnes qui viennent le consulter et de ne pas pouvoir les aider de façon efficiente.
Ne pas s'embarrasser de trop d'idées préconçues, éviter les interprétations fulgurantes pour rester au plus près du déroulement du quotidien, chercher à saisir l'enchaînement des faits, l'émergence des émotions, les moments où le client quitte la description du processus pour analyser réflexivement, s'imprégner de l'expérience de l'autre… tout en guidant l'entretien. Voilà sans doute la difficulté majeure de l'application de cette approche relationnelle : la recherche active du dépouillement.
La philosophie de nos formations
Centre de recherches et d’innovations avant tout, Écologie de l’esprit n’a pas pour vocation de proposer des formations longues. A titre personnel, je garde cependant l’envie de diffuser les dernières évolutions de l’approche dans différents secteurs des relations humaines : la santé mentale, mais aussi ses applications à l’entreprise, au secteur social et à l’enseignement. Des séminaires d’initiation aux fondements théoriques (systémique, constructivisme, pragmatique de la communication…) et à la méthode et aux techniques d’intervention sont proposés aux personnes et organismes intéressés.
Poursuivant ma collaboration avec Giorgio Nardone, je propose d’en partager les qualités émergentes lors de séminaires de perfectionnement, notamment ce qui me passionne aujourd’hui, à savoir une nouvelle formalisation du dialogue systémique et stratégique. Des formations à cette méthode sont organisées pour les thérapeutes et les personnes travaillant en psychiatrie.
Ces évolutions éclairent non seulement le travail thérapeutique mais également les interventions d’aide, de changement et d’accompagnement dans le domaine des entreprises et des organisations ; le coaching, bien sûr, mais aussi les interventions plus globales d’équipes ou, par exemple, de gestion de l’introduction d’innovations technologiques dans une organisation… Ce sont des sujets sur lesquels je continue à travailler avec mon collègue et ami Michael Müller, et que nous proposons d’ailleurs de partager avec vous dans un séminaire organisé à Arezzo, en Toscane.
L’entretien systémique et stratégique constitue un outil privilégié pour l’enseignement et le travail social, notamment dans l’Aide à l’enfance et la Protection judiciaire, mais aussi dans le travail des Maisons de justice. Ayant commencé ma carrière dans ce secteur, j’ai toujours à cœur de permettre aux travailleurs sociaux étaux enseignants de trouver à la fois plus de sens et plus de confort dans l’exercice de leurs diverses missions comme j’ai pu moi-même en faire l’expérience.
En résumé, Écologie de l’esprit organise des séminaires et des formations courtes, en Belgique, en France, en Suisse et parfois dans d’autres endroits. Certaines s’adressent à des personnes intéressées par l’approche et souhaitant en acquérir une vision globale et complète (« Les découvertes ») ; d’autres proposent des perfectionnements ou des applications spécifiques (« Pour les connaisseurs ») et une dernière vous propose même de suivre les traces de Gregory Bateson à Bali !
[ Menu ]
�(1) Heinz von Foerster, Bernhard Poerksen: Understanding Systems. Conversations on Epistemology and Ethics Kluwer 2002, p. 45.
(2) Cette propriété des systèmes vivants affirme que des causes différentes peuvent provoquer un effet semblable et que des causes semblables peuvent entrainer des effets différents. Un événement infime peut avoir des conséquences disproportionnées (cf. la théorie des « ailes de papillon ») dans la formation d’un système homéostatique. Cette propriété remet en question les théories déterministes du comportement humain qui reposent sur une logique linéaire : une même cause provoque toujours le même effet.
(3) Le phénomène de résilience en est une bonne illustration comme l’a admirablement montré Boris Cyrulnik.
(4) Les guillemets servent à distinguer ce que nous appelons croyances d’une acception uniquement « cognitive » de ce terme. Pour nous, il s’agit d’un biais perceptif global, qui inclut donc une composante émotionnelle importante, un objectif bien défini et spécifique, le tout chapeauté par une interprétation cognitive.
(5) Voir notamment son film Family Life (1971) directement inspiré des travaux des antipsychiatres anglais.
(6) Milos Forman : Vol au dessus d’un nid de coucous, 1975, d’après le roman éponyme de Ken Kesey (1962). Il faut signaler que, pour écrire son roman, Kesey a travaillé comme infirmier au Veteran Administration Hospital de Menlo Park (CA), là où Bateson et son équipe ont mené les recherches sur les paradoxes et mis au point la théorie de la double contrainte.
(7) J. Haley : Nouvelles stratégies en thérapie familiale, Jean-Pierre Delarge, Paris, 1979.
(8) P. Watzlawick, J. Weakland, D. Fisch : Changements – Paradoxes et psychothérapie, Seuil, Points, Paris,1975.
(9) Colson Whitehead : Underground Railway, Albin Michel, Paris, 2017, p 327.
(10) Lin Yutang : L’importance de vivre, Philippe Picquier, Paris, 2004, p. 170.
(11) Avec mon collègue Giorgio Nardone, nous avons déjà jeté les bases de ce projet. Voir : Wittezaele J.-J., Nardone, G. : Une logique des troubles mentaux, Seuil, Paris, 2016.
(12) Par exemple le « carnet de bord ». Le thérapeute propose au patient de se munir d’un petit carnet dans lequel il aura tracé différentes colonnes qu’il devra remplir scrupuleusement dès les premiers signes d’attaque de panique. Ces colonnes reprennent différentes rubriques : date, heure, lieu, symptômes physiques, etc. Le fait de prendre en compte son carnet de bord interrompt ipso facto les tentatives de solution.
(13) Ali Paya : Savoir réciproque, philosophie du cœur, in Alliage, n° 55-56, Mars 2004, pp. 118-134.
(14) On sait que les médicaments ne permettent pas toujours de faire disparaître certains symptômes gênants. On ne peut pas non plus prédire l’avenir, alors, pour éviter tout retour d’une crise, le médecin doit aller bien au-delà des doses qui soignent pour aller vers des doses qui empêchent de nuire.
(15) Pour plus d’informations sur cette méthode de psychothérapie et la manière dont elle envisage le traitement des troubles mentaux (phobies, TOC, dépression, troubles alimentaires et sexuels, paranoïa, psychoses présumées, etc.), voir J.-J. Wittezaele et G. Nardone : Une logique des troubles mentaux, Seuil, Paris, 2016.
(16) Notamment dans l’Archéologie du savoir, Editions Gallimard, 1969. Ce concept est intéressant quoique un peu flou et assez simplificateur : aucune époque n’est en effet parfaitement homogène. Foucault a convenu lui-même des limites du déterminisme structuraliste.
(17) Nous nous sommes inspirés des ouvrages suivants : Wiplash, how to survive our faster future, J. Ito et J. Howe, 2016, Editions Grand Central Publishing, mais aussi de Homo Deus, Y.N. HARARI, 2017, Editions Albin Michel, ainsi que de Dans la disruption, comment ne pas devenir fou ? B. :Editions Les liens qui libèrent, 2016
(18) Plusieurs grandes compagnies d’électricité en Europe ont ces dernières années soutenu le développement massif de solutions de production d’électricité décentralisées (éolien, solaire, etc.) tout en sachant que cela conduisait à l’arrêt total ou partiel de leurs grands moyens de production centralisés. Elles savaient qu’elles détruisaient ainsi de la valeur par dizaines de milliards d’euros mais elles l’ont fait pour essayer de survivre.
(19) Ce clivage peut conduire à des tensions, y compris psychologiques pour le dirigeant qui peut se sentir écartelé.
(20) Il sera aussi intéressant d’observer à cet égard le rôle que les médias et réseaux sociaux vont jouer dans la chute de popularité de TRUMP et dans un impeachment qui pourrait se dessiner.
(21) Notion développée par Alain de Vulpian dans Eloge de la métamorphose, Editions Saint Simon, 2016.
(22) Ce titre, un peu pompeux, est un clin d’œil respectueux à Gregory Bateson qui, au début de son ouvrage La nature et la pensée, dresse une liste de prémisses issues de la cybernétique qu’il a appelée : « Ce que tout sait ».
(23) Les deux disciplines s’intéressant aux phénomènes complexes à causalité circulaire, elles ont fini par se fondre en ce que l’on appelle généralement aujourd’hui l’« approche systémique ».
(24) La théorie de la double contrainte fut proposée au départ comme une théorie explicative de la schizophrénie.
(25) G. Bateson, La peur des anges, p. 36.
(26) Voici une demande qui m’a été adressée et qui va dans ce sens : « Personnellement intéressée par la thérapie stratégique je souhaiterais organiser au sein de la clinique universitaire où je travaille une formation en communication stratégique, car nous sommes continuellement confrontés à des problèmes de communication interpersonnelle. Pouvez-vous me dire quelle serait la taille de groupe adaptée pour cette formation? »
(27) Pour plus d’informations sur la méthode, je renvoie le lecteur à l’ouvrage Une logique des troubles mentaux, de Giorgio Nardone et moi-même (Éditions du Seuil, Paris, 2016)
(28) Pour plus de détails sur cette question, voir notamment : Cl. Seron et J.-J. Wittezaele : Aide ou contrôle – L’intervention thérapeutique sous contrainte, De Boeck, Bruxelles, 1992.
(29) Dans la mesure, bien sûr, où ces comportements sont compatibles avec les règles définies par l’État de droit, cadre général de toute intervention.
(30) F. Jullien, Figures de l'immanence, p. 225.
[ Menu ]